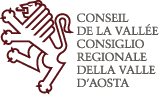Oggetto del Consiglio n. 725 del 3 luglio 2019 - Resoconto
OGGETTO N. 725/XV - Approvazione di mozione: "Promozione dell'uso della lingua francoprovenzale/arpitana e walser in occasione di eventi prettamente valdostani".
Rini (Presidente) - Punto 5 all'ordine del giorno. Per l'illustrazione, la parola al collega Luboz.
Luboz (LEGA VDA) - Ce n'est peut-être pas un des problèmes les plus graves qui affligent notre région, j'en suis tout à fait persuadé, mais c'est de toute évidence un problème, un phénomène envers lequel, à mon avis, nous devons prêter toute notre attention. C'est la perte d'une identité, la perte des racines, la perte des langues, en bref la perte du sens identitaire qui pendant longtemps a caractérisé les habitants de notre région. Ce phénomène de standardisation et d'homologation de toutes les caractéristiques culturelles et particulières, qu'un groupe d'hommes et de femmes a bâti le long d'un long processus de vie et donc d'une histoire commune, est à notre avis et à mon avis d'une gravité brutale et souvent nous en sommes complices: on tue petit à petit ce particularisme dont nous étions fiers défenseurs.
Tout à l'heure, dans un instant, je réciterai un petit texte poétique et le "ils" du petit récit, à la troisième personne plurielle, il faudrait le recadrer, à mon avis. C'est à nous-même qui peut s'adresser ce texte. Aucun venu de l'étranger et là pour nous voler la lune: c'est notre faute, exclusivement la nôtre. Mais voilà ces deux lignes dont je vous disais: "La première nuit ils s'approchent et cueillent une fleur de notre jardin, et nous ne disons rien. La deuxième nuit ils ne se cachent même plus, ils piétinent nos fleurs, ils tuent notre chien, et nous ne disons rien. Vient le jour où ils entrent chez le plus faible d'entre nous, ils nous volent la lune et, comme ils savent que nous avons peur, ils nous arrachent la voix de la gorge et nous, qui n'avons jamais rien dit, nous ne pouvons plus rien dire".
Ce texte, bien évidemment, n'a pas été écrit pour le peuple valdôtain, a été écrit pour les Indiens d'Amérique, qui malheureusement ont vécu une expérience bien pire que la nôtre, même pas à mettre en ressemblance. Bien qu'un ethnocide a été commandité est accompli envers le peuple valdôtain, je le répète hélas, un peu avec la complicité des valdôtains, au moins d'une partie qui a manifestement permis à l'esprit peu veillant de s'endormir, bercé de l'apparent bien-être matériel qui s'est diffusé dans notre région. Si ce bien-être est remarquable - il serait injuste ne pas le souligner - il faut cependant reconnaître un appauvrissement culturel envers nos langues traditionnelles, en particulier envers le patois et les parlés germanophones de la vallée de Gressoney, mais aussi pour le français. Par cette initiative nous voulons mettre l'attention sur cela précisément et donc sur la nécessité de revaloriser quelque chose d'extrêmement importante, qui est en train de mourir petit à petit.
L'arrachement de la voix de la gorge remonte en temps assez lointains. Il est utile de rappeler "diritto e necessita d'abrogare il francese come lingua ufficiale in alcune valli della provincia di Torino" de 1861 et les tentatives d'italianiser notre pays d'Aoste par l'interdiction d'enseigner le français dans nos écoles au temps du fascisme, il faut cependant souligner sans une grande réussite, au moins jusqu'en 1921. En effet, sur la base des recensements le pourcentage des francophones, y compris les patoisants, est passé de plus de 95 pour cent en 1861 à 88 pour cent en 1921, c'est-à-dire qu'à la veille de la période fasciste notre pays d'Aoste était encore très francophone. Aujourd'hui ce qui ne s'est pas réalisé par le fascisme, hélas, est en train de se concrétiser par l'évolution de la société elle-même: on le voit et on s'en aperçoit aussi dans cette salle. Je crois cependant que personne ne puisse se réjouir de l'italianisation de cette terre, même pas les francophobes les plus acharnés, car qu'ils sont quand même conscients, parfois plus que nous, de notre différente réalité historique, profondément francophone et arpitane. C'est notre histoire qu'ils témoignent, nos noms de famille, nos toponymes, nos patronymes.
Si on constate avec sincérité et droiture l'état de santé de nos langues, il est urgent, à mon avis, de faire des sérieuses réflexions à ce sujet. C'est pour cela que nous avons cru utile d'inviter le gouvernement régional à se faire promoteur, envers ceux qui organisent des événements publics d'intérêt général, mais caractéristiques et significatifs pour notre région - je pense à la bataille des reines, je pense aux sports de noutra tera, je pense aux Floralies vocales - à se faire promoteur d'une utilisation des patois et des parlés germanophones, là ou possible, dans les présentations, dans les chroniques, ou dans les expositions de ce qui est représenté. Il nous semblerait tout à fait naturel, logique, normal qu'à certaines occurrences le patois soit employé au lieu de l'italien, sans que cela soit perçu comme une fermeture envers ceux qui ne le comprennent pas, ou prétendent de ne pas le comprendre. Tout au contraire, pour les approcher à notre langue qui doit et peut survivre, si nous le voulons avec fermeté et courage. Certes, si nous ne faisons rien cela qui avait prévu Cerlogne, que le patois et le français disparaîtront ensemble de notre vallée, se produira même assez vite et la Vallée d'Aoste aura perdu beaucoup de ses couleurs.
Volevo leggervi ancora due righe, che avevo trovato su La Stampa già alcuni anni fa, proprio riguardo alla perdita della lingua madre, quella che per me è il patois, il francoprovenzale, l'arpitano, come vogliamo definirlo. "Per chi pensa che ogni lingua incarni un insostituibile è originale punto di vista sul mondo, una perdita del genere rappresenta un disastro, anche peggiore della scomparsa di specie vegetali o animali". Sur ce point l'auteur du texte a peut-être exagéré, mais ce qui suit est fort intéressant: "Quando una lingua muore non ne soffre soltanto la tradizione in cui quella lingua si esprimeva, ma l'umanità intera, che si vede così privata di un elemento di diversità, di fantasia, di invenzione. All'indomani di questa morte ci si scopre tutti più poveri, un po' più imbelli, un po' più soli".
Dalle ore 10:25 assume la presidenza il vicepresidente Farcoz.
Farcoz (Président) - Nous sommes en discussion générale. La parole au collègue Vesan.
Vesan (M5S) - Non raggiungerò i toni lirici del collega Luboz nella presentazione della sua mozione, ma tenderò a essere assolutamente pragmatico nei confronti dell'impegno presentato, a tutela della lingua patois e della lingua walser sul territorio valdostano. È vero, inevitabilmente, che se non vengono fatte azioni poste alla loro conservazione e al loro uso siamo destinati a perderle e che questa sarà comunque una perdita di identità per tutti noi. Però, sulla scorta di questo, l'uso di una lingua è fondamentale per quello che riguarda la possibilità di comunicare e non dovrebbe essere utilizzata in modo escludente. Quindi vorremmo proporre, se possibile e se i colleghi che hanno presentato questa mozione lo ritengono opportuno, un emendamento sulla definizione degli eventi prettamente valdostani. Non abbiamo nessun problema a riconoscere quelle manifestazioni - le manifestazioni zootecniche, le manifestazioni che riguardano il mondo rurale e gli sport popolari, nelle quali per gli stessi spettatori o partecipanti all'iniziativa l'uso della lingua preminente è, per fortuna, ancora il patois - per le quali la lingua patois possa essere anche usata come lingua ufficiale. Siamo un po' perplessi per quello che riguarda gli eventi organizzati dalle Proloco. Sostanzialmente le Proloco sono finalizzate alla promozione del territorio e spessissimo, in gran parte, le manifestazioni organizzate dalle Proloco sono finalizzate a presentare il territorio a gente che non parla patois e che avrebbe magari possibilità di capire addirittura più il francese che non l'italiano. Quindi volevamo chiedere se era possibile, di fronte a una nostra disponibilità a votare favorevolmente questa mozione, un emendamento che stralci solamente la frase "e gli eventi organizzati dalle Proloco". Di fronte a questa disponibilità noi saremo favorevoli a sostenere questa mozione presentata dal collega Luboz e dai suoi colleghi.
Président - La parole au collègue Bertin.
Bertin (RC-AC) - Come non essere d'accordo al sostegno e alla promozione del patois e della lingua walser! Lo dico non soltanto perché sono un patoisan e perché, come tutti, sono molto affezionato a questa lingua, ma perché, come sottolineava anche il collega Luboz, è un patrimonio di questa regione ed è una ricchezza che non va persa, che fa parte del territorio e che deve essere mantenuta viva. Però nel merito di questa mozione francamente non si capisce qual è il significato. Si vuole che il governo regionale faccia un auspicio? Che mandi una letterina alle Proloco o alle altre associazioni auspicando di utilizzare il patois, invitandoli o addirittura introducendo un obbligo, cosa che tra l'altro, a mio avviso, avrebbe l'effetto esattamente contrario? Vorrei capire il senso di questa cosa.
Mi pare che l'obiettivo di questa mozione da parte di alcuni della Lega sia quello di volersi appiccicare, attaccare una medaglietta rispetto a questo problema che c'è, che è serio e che va affrontato in modo diverso. Peraltro poi penso che i capi della Lega, intendo Manfrin e Spelgatti, probabilmente su questo aspetto, dato che non lo conoscono, sono certamente molto meno interessati. Mi pare il modo sbagliato di affrontare una questione che è seria e che, con il passare delle generazioni, lo è sempre di più, con il rischio di perdere una ricchezza importante per questa nostra regione. Ma non è in questo modo, a mio avviso, che può essere affrontata, in un modo che rischia un po' di trasformare il patois in qualcosa di folkloristico e non più vivo. L'obiettivo deve essere quello di rendere viva questa lingua e non certamente di trasformarla in un fatto folkloristico, come mi sembra si tenda in generale con certe iniziative, anche con un uso a volte - come si è fatto in questo Consiglio - che rischia di avere degli effetti negativi rispetto poi alla promozione e al sostegno della diffusione del patois e del walser nella nostra regione.
Président - La parole à la collègue Spelgatti.
Spelgatti (LEGA VDA) - Collega Bertin, mi dispiace deluderla, però evidentemente non conosce la storia della Lega Valle d'Aosta e non conosce nemmeno la storia della mia azione politica, visto che ha tirato in ballo proprio me. Benissimo, le faccio un riassunto rapido della situazione. Da quando ero stata eletta in consiglio comunale, nonché in qualità di presidente della Lega Valle d'Aosta, già ai tempi, una delle battaglie principali che ho portato avanti è sempre stata esattamente questa. Esattamente questa, perché la Lega Valle d'Aosta ritiene e io in primis ritengo, che la questione identitaria sia la principale per cui bisogna lottare. Ho sempre detto in tutti i comizi, in tutti gli interventi in consiglio comunale, in qualunque tipo di intervento, che parlo proprio in qualità di persona che si chiama Spelgatti, che non ha un cognome valdostano, di persona che non conosce il patois, perché sono figlia di bergamaschi; sono nata qua, ma sono figlia di bergamaschi. Proprio per questo, nel momento in cui faccio delle scelte, le faccio con cognizione di causa e non semplicemente perché ho un patrimonio familiare alle spalle; ed è proprio per questo che dò ancora più valore a determinate battaglie.
Parto dal presupposto che ogni terra sia portatrice di valori! Che uno sia nato qua, che uno abbia una tradizione familiare valdostana, che uno sia arrivato in Valle d'Aosta nel tempo o che uno, come me, sia nato qui, ma non sia figlio di valdostani, per potersi sentire davvero valdostani bisogna combattere per tutti i valori, per la tradizione, per la cultura e per tutto il patrimonio identitario di cui una terra è portatrice. Quindi probabilmente, ancora con più forza, proprio perché non è un patrimonio che io ho ereditato, ma un patrimonio in cui credo profondamente, le dico che io dall'inizio, dalla formazione di questa Lega Valle d'Aosta, e tutta la Lega Valle d'Aosta e tutti i membri della Valle d'Aosta credono profondamente in queste battaglie, perché noi partiamo dal presupposto che amiamo le diversità. Noi amiamo le diversità! Noi riteniamo che tutte le diversità siano fondamentali. Noi riteniamo che sia fondamentale, per poter guardare al futuro, partire dalle radici. Se si perdono le radici, ricordiamoci che un albero non crescerà mai sano. Ed è ciò che stanno facendo tutti quelli che tagliano invece le radici di questa terra e le radici di quelle che sono le tradizioni, le identità, la cultura di una popolazione, di un popolo e soprattutto, ripeto, di una terra che è portatrice di questi valori.
Per poter guardare al futuro bisogna davvero guardare al passato, cioè basarsi su delle fondamenta solide, altrimenti questa terra sarà omologata a tutte le altre terre, non ci sarà nessuna diversità fra la Valle d'Aosta e tutte le altre terre. Non ci sarà diversità fra la Valle d'Aosta e il Piemonte, fra la Valle d'Aosta e la Lombardia, fra la Valle d'Aosta e il Trentino, fra la Valle d'Aosta e le terre intorno francesi. Questo serve anche per guardare al futuro, perché tutto questo ha anche delle ripercussioni enormi dal punto di vista concreto, terra terra, di quello che può essere il turismo, di quella che è l'economia di un'intera valle.
Questi non sono solo discorsi astratti, ma estremamente concreti che hanno delle ripercussioni economiche importantissime. Un turista che viene in Valle d'Aosta deve trovare qualcosa di profondamente diverso rispetto a quello che può trovare nel momento in cui va nelle Alpi piemontesi, va nelle Alpi venete, va in qualsiasi altro posto intorno alla Valle d'Aosta. Ma non solo, bisogna salvaguardare le diversità di ogni singola vallata, perché la Valle di Cogne è profondamente differente dalla Valle di Gressoney, la Valle di Cogne è completamente differente rispetto a Courmayeur e così via. Ogni valle ha delle sue peculiarità e questo è un patrimonio che noi dobbiamo assolutamente salvaguardare.
Per cui la prego di non dire idiozie nel momento in cui dice: la Lega di Spelgatti la vede diversamente. Basta guardare alla mia storia, perché mi sento tirata in ballo personalmente, e a tutte le battaglie che ho portato avanti da sempre, per rendersi conto che lei sta dicendo qualche cosa che non ha nessun collegamento con la realtà. Questa è la Lega Valle d'Aosta. Questa non è semplicemente una battaglia di Luboz, di Lucianaz o di qualcun altro. La Lega Valle d'Aosta è stata costruita così, è stata costruita in questa maniera. Queste battaglie vengono portate avanti da chi non ha questo patrimonio e proprio perché le porta avanti vuol dire che ci crede in maniera profonda e che si attornia di persone che questo patrimonio invece ce l'hanno e quindi sono fondamentali. È per questo che la Lega Valle d'Aosta ha questa sua solidità. Ha la sua solidità proprio nel fatto che ci sono diversità di culture a monte, come patrimonio familiare che si porta avanti, ma identità di vedute per il futuro della Valle d'Aosta e per quello in cui si crede.
Queste battaglie vengono portate avanti per il patois, ma nella stessa maniera per il francese. Io ricordo che ho sempre detto che ho talmente rispetto per il francese che mi sono sempre rifiutata di fare, quando ero presidente, discorsi in francese, non perché io sia contro il francese, ma per la semplice ragione che purtroppo il francese in Valle d'Aosta non è stato sostenuto come avrebbe dovuto essere sostenuto, perché di fatto un bilinguismo reale non ce l'abbiamo. Quindi, per rispetto di questa lingua io evito di parlarla, nelle sedi istituzionali, da italiana che ha studiato il francese a scuola. Quando sono uscita dal liceo classico devo dire che il francese lo parlavo, posso dire, bene. Nel momento in cui sono passati gli anni e il francese non l'ho più esercitato, mi sento ridicola nel momento in cui parlo, perché ritengo che le cose quando si fanno si devono fare bene. Sentire palare me in francese: dopo tanti anni che non mi esercito in una lingua, io sono la prima a ritenermi ridicola. Non così tantissimi consiglieri che sento parlare in francese e mi fanno venire la pelle d'oca sulla schiena nel momento in cui lo parlano, perché sono assolutamente ridicoli. Non si può parlare in francese così, non si può violentare in questa maniera una lingua. Io sono la prima a non volerlo fare, per rispetto nei confronti di una lingua e non certo perché io sia contro il francese, ma tutt'altro. Il problema è che bisogna rivedere un attimino come viene insegnato il francese in questa Valle e quindi bisognerà fare delle battaglie per cambiare la situazione rispetto a quella che è attualmente. Io, ripeto, ne sono il primo esempio e, per gli studi che ho fatto, avendo studiato il francese da quando ero all'asilo fino all'ultimo anno di liceo classico, non è che io il francese non lo conosca, ma semplicemente quando il francese non lo eserciti, non lo parli e non pensi più in francese, nel momento in cui ti trovi a doverlo parlare sei abbastanza ridicolo: i termini non ti vengono, il francese non è fluente e bisognerebbe rifare dell'esercizio.
Non parli della Lega di Spelgatti come di qualcosa di differente rispetto a queste battaglie, perché queste sono le battaglie della Lega e, ripeto, basta guardare alla mia storia personale nella Lega e a tutte le battaglie che ho sempre portato avanti, per rendersi conto che tutto questo è un qualchecosa in cui non solo io credo profondamente, ma in cui tutti i membri della Lega Valle d'Aosta credono profondamente. Non sono battaglie di principi, non sono questioni semplicemente ideali. Sono questioni estremamente concrete, perché nel momento i cui si perde il patrimonio culturale di una regione, si perde tutto! Si perdono anche delle questioni estremamente concrete, come può essere il discorso del turismo, dell'economia e quant'altro, ma soprattutto noi siamo uomini che hanno un'identità e non si può perdere l'identità di un popolo. Quindi, per cortesia, eviti di dire idiozie: uso questo termine molto forte, perché su questo argomento mi sento presa in ballo e soprattutto si sta facendo un torto enorme a tutta la Lega Valle d'Aosta.
Président - La parole à la collègue Pulz.
Pulz (ADU VDA) - La motion proposée par la Lega de Salvini part du principe de réaffirmer la centralité de la langue francoprovençale. Mais où se situe t'elle en fait cette centralité? Le francoprovençal ne se projette que marginalement sur le panorama linguistique valdôtain, avec des mesures de sauvegarde globalement encore modérées, qui témoignes plutôt de sa non-centralité. On souligne donc l'importance de préserver la langue walser conformément à la loi nationale n° 482 de 1999, qui par ailleurs n'est pas non plus citée correctement dans la motion, si vous me le permettez, étant donné que la loi se réfère à une plus générique protection linguistique des minorités germaniques et non pas de manière plus spécifique à la minorité walser. De notre côté nous souhaiterions d'avantage qu'on étende la protection de la langue allemande en tant que langue toit, lingua tetto, à savoir une langue de culture orale et écrite plus proche au parler walser, tout comme l'on fait dans le reste de la Vallée d'Aoste, en protégeant le français en tant que langue toit du francoprovençal. Et cela même si la relation entre le francoprovençal et la langue de Molière est moins marquée, par rapport à celle entre le titsch, le töitschu et la langue de Goethe.
L'engagement prévu par la motion est celui de promouvoir l'arpitan. Je fais remarquer que ce terme introduit par le Movement Harpitanya au cours des années '70 renvoi à un idéal de la gauche maoïste, avec des liaisons arpitanes-basques remarquables et bien plus progressistes, alors qu'aujourd'hui cette soudaine défense des langues arpitanes est incompréhensiblement pour nous, pour moi, devenu apanage de cette nouvelle droite, qui mine l'essence même de la protection de la diversité. Il s'agit d'une contradiction qui paraît étonner aussi le gypaète de la Jeune Vallée d'Aoste; en effet nous ne l'avons plus vu survoler notre territoire, peut-être il s'est caché.
La motion explicite aussi, comme le soulignaient les collègues du Movimento 5 Stelle, que cette protection doit se réaliser dans la promotion et le récit d'événements valdôtains. On demande donc que l'arpitan soit utilisé à l'occasion de micro-événements locaux, en le confinant ainsi toujours davantage aux marges de la culture de la Vallée d'Aoste. Ainsi il ne s'agit pas de préserver la langue, mais de la reléguer dans la sphère restreinte des discours zootechniques, où par ailleurs elle est déjà bien vivante. La véritable innovation consisterait par contre à l'élargir à d'autres secteurs culturels, pour lui rendre le prestige auquel elle aspire depuis des années et qui ne lui est pas encore accordé, au moins pas totalement. Au contraire, procéder à un résumé en italien ou français serai, selon nous, l'échec même du projet. Personne ne s'intéresserait à la langue arpitane, étant donné que les deux langues dominantes de notre panorama linguistique agiront en intermédiaire. Si les défenseurs officiels des minorités linguistiques ont une véritable proposition, qu'ils la formalisent dans une proposition de loi et non pas par le billet d'invitation à des comportements improvisés, qui ne sont pas en mesure de modifier vraiment la situation.
Pour conclure, la langue doit rester un moyen de communication, un pont qui puisse être un lien et non pas une occasion de replis identitaire et d'exclusion de toute diversité, et surtout pas un moyen pour insulter une dame, même si elle se permet et se permettra de critiquer dans une normale dialectique politique certaines positions néofascistes de Salvini; jamais à cœur léger, je vous l'assure. Le vote de ADU VDA est donc une abstention, due essentiellement aux imprécisions et aux limites présentes dans le texte même de la motion.
Président - La parole au vice-président Distort.
Distort (LEGA VDA) - Con piacere ho seguito l'intervento della collega Pulz e con piacere devo dire che sono sorpreso per l'affermazione ideologica, profonda e perfettamente condivisibile di una visione conservatrice molto più ardita della nostra. Nel suo discorso il pensiero di dare spazio al francoprovenzale in quanto espressione della cultura di un popolo, al di là del perimetro estremamente limitato di una mozione, non può che essere apprezzato. Quindi, come ieri il collega Aggravi diceva al collega Marquis "benvenuto in un panorama forse più leghista del nostro", in questo intervento dico "benvenuta collega Pulz in un panorama molto più identitario del nostro"; salvo il finale, che riporta il suo intervento nei binari dell'ideologia del partito che deve giustamente rappresentare la linea autoapologetica, che comunque le è concessa per quello che ritiene un attacco personale. Io allargo il discorso e non centro completamente il mio intervento su un dialogo tra me e lei, ovviamente.
Detto questo, io vorrei aggiungere alcuni elementi. Questa mozione non ha uno scopo marchettaro: non c'è nessuna marchetta dietro questa mozione. Il pensare che ci sia una marchetta e pensare che voglia esserci una volontà di bandierina leghista per il tema del francoprovenzale, permettetemi, è l'espressione di quel proverbio che dice "Chi ha il sospetto, ha il difetto". Spero che nessuno in quest'aula si collochi in questa linea. Non è neanche un voler esprimere la modellità di gestione di un codice linguistico. La lingua non è un codice di comunicazione. Il codice di comunicazione è un aspetto della lingua. La lingua è espressione, cioè esprime, rappresenta, racconta qualcosa che va ben al di là del codice comunicativo. È come tale che noi la proponiamo.
Vi cito un piccolo esempio, un fatto avvenuto di recente. Il Presidente del Consiglio ieri ha accennato in apertura dell'adunanza all'incontro avvenuto e presieduto da me come rappresentanza della Valle d'Aosta al Parlement du Canton du Jura, per la celebrazione del quarantesimo anniversario della loro entrata in sovranità. Sovranità, questa parola che fa così paura oggi, che tra l'altro è né più né meno che espressione della seconda parte del primo articolo della Costituzione italiana: "La sovranità appartiene al popolo". Fatto questo inciso, in quell'occasione io mi sono trovato a partecipare al pranzo, fortunatamente potendo esprimermi in un francese perlomeno un po' più utilizzato per varie esperienze, rispetto alla situazione di difficoltà cui accennava la collega Spelgatti. Tra l'atro, non per difenderla perché, come ho già detto più volte, ci manca solo che un architetto difenda un avvocato, però effettivamente il senso della dignità e il rispetto che esprime la collega Spelgatti nel momento in cui parla del francese è qualcosa che trova il mio totale riconoscimento. Il discorso è questo: a un certo punto io mi sono trovato nei tavoli tra le chiacchierate. Immaginatevi un pranzo istituzionale con centinaia di persone in giacca e cravatta che si parlano: dicono del più e del meno, delle varie realtà politiche, di qualcosa che si collega comunque a questi discorsi istituzionali. Immaginate il livello di attenzione?! Immaginate quanto sia divertente?! Sì, certo, c'è una componente molto divertente. È molto bello il dialogo, però è normale ed è una questione umana che l'attenzione tenda a diminuire; si parla un po' del più e del meno. C'è stato un momento in cui, parlando con quel mio vicino, io ho raccontato il discorso della lingua, del francoprovenzale che parliamo noi. A lui è venuta in mente un'idea ed è andato a chiamare negli altri tavoli uno che parla il dialetto del Jura e allora abbiamo iniziato a parlarci: lui mi parlava in dialetto del Jura, io parlavo in dialetto valdostano, io parlavo il patois, io parlavo il francoprovenzale. È chiaro che il dialetto del Jura è di origine più vicina al territorio francese storico ed è abbastanza lontano rispetto al nostro francoprovenzale. Addirittura ha dei legami linguistici con il piemontese, però fortunatamente io conosco sia il patois che il piemontese e quindi riuscivo a capire perfettamente tutto quello che diceva e gli rispondevo a volte in francoprovenzale e a volte in piemontese. Questo discorso surreale, questo dialogo - dialogos! - surreale ha scatenato l'attenzione di buona parte dei tavoli.
È chiaro che noi non vogliamo spettacolarizzare nulla. Nel momento in cui trattiamo il tema di una lingua, dell'espressione di un popolo, di una cultura, noi andiamo a toccare qualcosa che si allarga fino ai confini del sacro. Però questo rivela tutta la ricchezza che si porta il dialetto, tutta la ricchezza che si porta una lingua storica, la lingua madre di un popolo. È chiaro che questo discorso si inquadra perfettamente in un progetto di società che vuole essere in grado di sostenere le prove quotidiane, le prove della società di oggi, della realtà internazionale e mondiale di oggi. Di fronte al mondialismo, di fronte alla globalizzazione, di fronte a una omologazione, di fronte a un mercato unico e a queste sfide aggressive, dure e impegnative, viene da dire: ma cosa c'entra?! Noi siamo qui a discutere, come ha introdotto benissimo il collega Luboz, su un problema relativo all'utilizzo di una lingua in certe situazioni. Ma vedete, noi abbiamo la fortuna di appartenere a una società che si è costruita storicamente e culturalmente attraverso dei valori.
Sono valori che hanno le loro radici, lo dico in modo laico, nella tradizione cristiana. Nel vangelo di Matteo, al capitolo 25, vi ricordate del servo buono? "Sei stato fedele nel poco, ti darò autorità nel molto": questo è lo spirito! È dalle piccole cose, è da queste attenzioni, dalla risposta a queste piccole sfide che noi mettiamo in moto i meccanismi per le grandi sfide. Il meccanismo fondamentale per la grande sfida si gioca tutto sull'identità. Non è una posizione della Lega Valle d'Aosta, non è una posizione di quell'espressione "Lega Spelgatti" assolutamente avulsa dal contesto. La collega Spelgatti è parte della Lega come lo sono io, come Sammaritani, come Aggravi, come lo sono gli altri miei colleghi alla mia sinistra: siamo parte dello stesso progetto.
In questo progetto che mette in campo e sostiene una sfida per una società, per proporre un progetto di società, noi mettiamo in atto il tema fondamentale dell'identità. Tra l'altro, a dirlo non dovrei neanche essere io a livello politico, ma potrebbe essere un semplice sociologo o addirittura un'economista. Qui entro nel campo del collega Aggravi: spero di superare il suo esame. L'aspetto economico che ha citato la collega Spelgatti. Di fronte a un mercato globale ci sono solo due regole, solo due macro regole che tengono: si propone il prodotto al miglior prezzo o si propone il prodotto unico; l'unico, quello che si trova solo lì.
È sotto questo punto di vista che il progetto di chi ha a cuore l'identità di un popolo non vuol dire esprimere l'atteggiamento del naufrago, di una cultura che sta morendo, che si aggrappa al relitto di una nave. Questo non è lo spirito nostro, questo non è lo spirito di una società sana. Lo spirito di una società sana è lo spirito di una società che sa di essere seduta su una miniera d'oro. Questa miniera d'oro si chiama identità, perché nel momento in cui questa identità è riconosciuta e valorizzata, oltre a essere coerenti con sé stessi, coerenti con chi siamo, coerenti con dove viviamo, coerenti con il nostro passato e quindi con la nostra identità, noi siamo coerenti al fatto di proporre qualcosa che è estremamente unico. Quindi la lingua, quindi i nostri beni culturali! I nostri castelli non sono semplicemente dei castelli. I nostri castelli hanno un nome e un cognome, una collocazione, una storia; sono il patrimonio unico! I nostri prodotti, la filiera della nostra attività agricola, di allevamento, dell'artigianato. È tutto collegato e tutto diventa l'elemento chiave della sfida.
Concludo il mio intervento dicendo che questa mozione non è marchetta, non è bandierina, non è occuparsi di un argomento che è semplicemente un codice di comunicazione, ma è un banco di prova per ognuno di noi, un banco di prova per uno schieramento di maggioranza che rappresenta l'impegno di governo per la nostra comunità. È l'occasione chiara e inequivocabile che o si è d'accordo o si è contrari. Questo è lo spirito e sotto questo punto di vista io vi invito a vedere tutta la dimensione di questa mozione.
Président - La parole au collègue Barocco.
Barocco (UV) - Je crois qu'un argument si important comme l'élément identitaire, la langue, demande sans doute de notre part un effort de confrontation sur ce thème. Moi je veux remercier le conseiller Bertin, qui avec sa provocation a donné la possibilité à nous tous de nous pencher sur ce thème et surtout je crois que les collègues de la Lega ont finalement explicité leur attachement aux facteurs identitaires, et de ça je me réjouis. Je vois un attachement à l'identité, au territoire, à notre langue et si nous sommes arrivés ici dans cette salle à partager la valeur de nos langues beaucoup de fois, mais maintenant aussi avec beaucoup de conseillers qui expriment leur attachement à cette langue, je crois que c'est aussi dû au travail qui a été fait dans ces années: de droite ou de gauche, mais elles sont plusieurs les personnes qui ont travaillé et travaillent dans ce domaine.
Le collègue Luboz a seulement, je crois, donné un petit message. Par exemple, parler de patois et de arpitan dans l'histoire de notre région, c'est déjà se rattacher à un gros débat sur ce thème. Un débat qui a été positif, mais qui quand même a porté de l'avant et a contribué à mieux cerner le problème linguistique de notre région. Moi je tiens seulement à rappeler deux personnes qui souvent ont été rappelées dans cette salle: je veux le refaire parce que je crois que Madame Viglino et Monsieur Gex doivent être rappelés dans ces moments. Donc, si nous sommes arrivés à ça c'est merci à un grand travail.
Sur la question de l'emploi des langues: Mesdames et Messieurs, chacun de nous parle le français qu'il connaît et dans la façon qu'il pense meilleure. C'est un effort, sans doute c'est un effort, et moi je dis que quand même l'école valdôtaine n'est pas à mépriser. Probablement nous tous nous sommes à mépriser, parce que nous ne donnons pas un engagement de témoignage, même en risquant quelque piètre figure dans l'emploi de cette langue. Però vorrei altresì dire: siamo così rigidi e censori nell'uso della lingua di Molière, ma non so quanti di noi, usando la lingua di Dante, siano andati a lavare i panni in Arno. Anche lì, se dovessimo proprio usare la matita rossa, quanti errori! Questa è solo una costatazione.
Su questa mozione cerco di tornare all'obiettivo e non sarei così "o si è contro o si è a favore". Se c'è un momento come questo per cercare anche una sintesi, perché no! Ci sono degli elementi della mozione che devono essere meglio spiegati: penso che sia necessario, affinché una pregevole iniziativa non vada incontro poi a degli effetti negativi, cioè per esempio quello che ha sollevato il consigliere Bertin. Facciamo attenzione alle imposizioni e soprattutto all'imposizione culturale: è una cosa a cui porre molta attenzione.
La difesa identitaria, invece, è senz'altro necessaria. In questi giorni si sta parlando molto di Europa, la quale forse ha fatto poco per affermare le sue identità; questa è una mia posizione. Nell'Union Valdôtaine stiamo lavorando, si è lavorato e cercheremo ancora di lavorare. Se l'Union Valdôtaine, con tutti i suoi errori, è riuscita a far passare un messaggio che le lingue sono importanti, penso che almeno questo - le lingue della Valle d'Aosta: il francese, il patois e le lingue germanofone della Valle del Lys, che penso debbano essere ancora maggiormente salvaguardate, essendo una minoranza nella minoranza - sia un risultato positivo e cerchiamo di mettere a fattor comune questo risultato anche oggi.
Président - La parole au collègue Lucianaz.
Lucianaz (LEGA VDA) - Je remercie mon collègue Luboz pour avoir proposé cette intéressante motion et pour le débat qui a suivi. Je parlerai français, langue officielle en Vallée d'Aoste, comme d'ailleurs ne l'est pas le francoprovençal, hélas, justement pour ne pas donner d'autres incompréhensions.
La collègue Pulz, si j'ai entendu, hier peut-être s'est fâchée, mais aujourd'hui elle a utilisé le mot insulter. Moi je n'ai insulté personne, j'ai utilisé en langue provençale un mot, un adjectif qui n'a rien de...
Voix hors microphone.
Il n'existe pas? Alors, excusez-moi Monsieur Nogara, mais vous ne connaissez vraiment pas notre langue!
Voix hors microphone.
Ce n'est pas ma faute. Monsieur Nogara, il y a des bons cours de francoprovençal. Le mot que j'ai utilisé hier, dans mon patois n'as rien d'offensif - pas du tout! Et si vous voulez on en discute - et donc voilà pour dire que, si vous êtes d'accord, on parlera de l'étymologie et des significations des mots en francoprovençal.
C'est justement sur ce fait que je veux répondre même aux provocations du collègue Bertin, parce que voilà que "gli aspetti negativi e la folklorizzazione" c'est exactement ça. On ne connaît pas la langue qu'on veut utiliser, on ne la connaît pas dans toutes ses facettes et surtout on ne l'utilise pas, collègue Bertin, parce que "gli aspetti negativi" c'est le fait de ne pas l'utiliser sûrement dans les occasions officielles, comme dans cette salle. C'est là qu'on donne prestige à une langue, pas seulement aux fêtes du patois et au Concours Cerlogne: c'est dans les occasions officielles qu'on doit soutenir et utiliser justement nos langues, si on veut leur donner du prestige.
Moi, j'ai toujours été critique envers l'Union Valdôtaine et avec les mouvements qui ont dépendus d'elle, parce qu'ils n'ont jamais fait assez, à mon avis, pour notre langue. C'est à cause de ça que je fais des provocations en utilisant le francoprovençal dans cette salle. Je m'excuse pour les personnes qui ne comprennent pas totalement, mais il y a une loi italienne, justement rappelée par la collègue Pulz, qui défend cette utilisation et met à disposition de la population les traducteurs et les traductions pour tous les actes publics; ce n'est qu'à la volonté de ce Conseil de les utiliser.
Je remercie surtout les collègues Distort et Spelgatti pour l'appui qui ont donné à cette initiative et je prie la collègue Certan de dire la sienne, parce que je l'entends parler et toujours commenter, mais je ne comprends pas un mot de ce qu'elle dit.
Bon, dit ça, on se battra toujours pour notre langue et je me souviens il y a vingt ans les grandes discussions qu'on a eues au Centre d'étude francoprovençales, alors que le francoprovençal, le patois, n'était considéré qu'un dialecte. On s'est battus énormément pour essayer au moins d'accepter la définition de langue. Heureusement il y a des linguistes au niveau international, comme Gaston Tuaillon et d'autres linguistes, le professeur Martin de Lyon, qui ont beaucoup avancé sur ce point et là c'est la Vallée d'Aoste qui a été la dernière, à mon avis, qui a reconnu le fait qu'elle soit une langue.
Président - La parole à l'assesseur Viérin.
Viérin (AV) - J'ai écouté avec attention les interventions sur ce thème intéressant: certaines ont été des interventions, d'autres semblaient plus des leçons. Je crois personnellement que la langue elle n'a pas d'étiquette, la langue et les langues n'ont pas des mouvements, des partis. La politique doit penser à faire de la politique, à mettre en action des mesures de défense et de protection des langues, en ne pas essayant à nous partager en mettant des étiquettes sur des thèmes linguistiques et culturels.
Je n'ai pas bien saisi la dernière intervention sur le fait de ne pas comprendre les mots qui arrivaient des bancs du gouvernement. Monsieur Lucianaz, je vais vous répondre en tant qu'assesseur à la culture. Quelqu'un a rappelé Maria Ida Viglino, quand à un certain moment il y avait eu quelqu'un qui avait dit dans les journaux qu'il ne comprenait pas pourquoi à Aoste il n'y avait pas un auditorium. Alors Madame Viglino l'avait appelé dans son bureau en lui disant: "monsieur, si vous ne comprenez pas les choses, n'allez pas le dire dans les journaux". Cela pour dire que chacun comprend ses propos, chacun comprend ses langues.
Je partage le fait qu'avant tout pour défendre une langue il faut la parler. Il faudrait se mettre d'accord: je partage la considération que le patois en effet est une langue. Il a été défini dans quelques interventions plusieurs fois comme un dialecte: ça me blesse! C'est le collègue Lucianaz qui l'a défini un dialecte. Alors, j'essaierai de mettre un peu d'ordre dans ce qui a été dit et surtout de rappeler un peu la situation actuelle de la question linguistique et culturelle valdôtaine. Beaucoup de choses ont été dites, mais même quelquefois avec un peu d'approximation.
Je partirais par quelques affirmations, parce qu'il y a eu pas mal de contradictions (et justement!) dans les interventions, car chacun a sa nuance, chacun a son idée, mais quand le nuances sont fortes et différentes dans le même sens d'appartenance, après ça devient peut-être difficile à expliquer. En remerciant le collègue Luboz pour son exposition, je crois qu'il faut être en effet attentifs sur le thème linguistique, il ne faut pas être passéistes, il faut être actuels et modernes et il ne faut pas non plus, en rappelant Chanoux et le saule pleureur, pleurer sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut prendre acte d'une situation, comprendre comment on peut travailler pour améliorer la situation, en sachant que la globalisation existe, en sachant qu'il y a eu une évolution culturelle qui ne dépend pas seulement de nous, mais que la Vallée d'Aoste a travaillé dans les décennies, même si vous pouvez ne pas être d'accord. Justement quelques administrateurs ont été cités, mais il n'y a pas seulement les gens qui ont fait de la politique, il y a aussi beaucoup de gens qui ont été dans les sociétés savantes, qui ont travaillé sur le territoire pour maintenir une identité et une langue.
Je ne partage pas trop le passage ou vous avez dit, collègue Luboz, "ils". La vôtre est une intervention assez de fermeture, par rapport à quelqu'un qui est venu nous envahir. Par contre, j'ai apprécié une partie de l'intervention de la collègue Spelgatti qui a dit que cette communauté a su intégrer sa population, même celle qui n'était pas valdôtaine, en lui donnant la possibilité de se reconnaître dans des éléments qui sont aussi et surtout linguistiques, à savoir notamment le français, le patois et le walser, pour ceux qui se sont établis dans ces vallées. Mais le nous et vous n'a jamais été la politique de la communauté valdôtaine d'un point de vue culturel, et j'essaierai de m'expliquer.
Ils sont venus, ils ont cueilli une fleur et après il ils nous ont envahis. Je crois que ce qu'on a essayé de faire dans les générations, en étant numériquement inférieurs comme valdôtains, comme francophones et patoisants à l'intérieur de cette communauté, c'est de donner, aussi et surtout, la possibilité à ceux qui n'étaient pas valdôtains de pouvoir accéder à ce patrimoine. Combien d'entre vous ont été dans des familles patoisantes et les parents même n'ont pas parlé patois à leurs enfants! Combien d'entre vous ne parlent pas patois à leurs enfants? C'est sur cela qu'on doit s'interroger. L'administration peut faire des grands efforts, mais le premier élément de cette communauté c'est la famille. Et le premier élément de la famille c'est qu'il faut donner la possibilité aux familles valdôtaines, en sachant qu'il y a des familles qui ne sont pas purement francophones, ou qui ne sont pas purement patoisantes, d'avoir cette possibilité.
Quel est-il le raisonnement que nous avions fait? Nous avons travaillé dans les décennies pour maintenir cette identité. Comment le patois est-il sauvegardé en Vallée d'Aoste? Il y a eu dans les années septente - comme ça on utilise les termes de nos frères valaisans, sur une question linguistiques d'une francophonie qui est différente par rapport, par exemple, à la francophonie parisienne - il y a eu la réaction post '68 campagnarde en Vallée d'Aoste. C'étaient les années des centres culturels, c'étaient les années de Magui Bétemps. Vous avez cité des poètes ou des littéraires hors de notre Vallée, moi je cite Magui Bétemps: "chaque culture qui meurt, pour petite qu'elle soit, chacun de nous a perdu quelque chose", en patois "tzacque culteua qui mouée, peu petchouda que fisse, tzaque de no a perdu cahque tchouza, totta l'humanitou".
Ce qui a été fait dans ces années c'est que le patois a été sauvegardé grâce à ces centres culturels. Nous étions petits et nous participions aux rendez-vous valdôtains, nous participions aux ateliers de théâtre populaire. Le théâtre populaire et la musique populaire ont sauvegardé et ont sauvé le patois, ce qui ne s'est pas passé en France, ce qui ne s'est pas passé en Savoie, en Haute-Savoie, dans une partie du Piémont et qui ne s'est pas passé aussi dans une partie de la Suisse, même romande. Nous avons des similitudes, collègue Distort, plutôt avec la partie valaisanne, si nous pensons que le patois d'Evolène est le patois de chez-nous: ils disent iò et oi par rapport au patois de la pleine. C'est le patois de la pleine: le Col Collon nous divise, mais l'identité nous joint. Le patois d'Orsières aussi.
Je voudrais souligner que le patois s'est conservé en Vallée d'Aoste, comme nulle part au monde! Donc je veux dire qu'on doit faire une photographie justement attentive de la situation culturelle, mais nous ne devons non plus oublier que le patois existe presque exclusivement en Vallée d'Aoste et que nous sommes un modèle! Marc Bron est un exemple de qui est venu en Vallée d'Aoste pendant des décennies dire: "ah, mais vous avez quand même réussi à sauvegarder le patois". Bernard Borné, qui a était président du Valais, est venu combien de fois me dire et nous dire: "vous avez fait comment à mettre le patois si fort dans les écoles?". Nous avions fait à l'époque une opération culturelle, nous avions fait une lettre adressée à tous les parents des élèves en disant: nous ne voulons pas obliger et imposer une langue - et j'arriverai à l'imposition, ou à la langue de régime - nous voulons donner une possibilité en plus, même à ceux qui ne sont pas valdôtains, de se reconnaître dans cette communauté en ayant une possibilité en plus. Je cite Patrizia Lino (on a fait une exposition et un livre sur elle), une infirmière de Bergamo qui est venue en Vallée d'Aoste et qui a ressentie l'exigence de savoir le patois, pour avoir une possibilité en plus pur ses malades qui savaient le patois. Soigner une personne en sachant aussi ça langue, car souvent la limite est de dire: "je ne m'exprime pas dans cette langue, parce que je ne le sais pas et je le partage". C'était une sensation et une exigence de ces gens et nous avions parlé d'une nouvelle génération de patoisants: c'étaient les nouveaux patoisants.
Cela pour dire que, quand on a un patrimoine identitaire, il ne faut pas seulement le conserver jalousement. Il faut le conserver, mais il faut le mettre à la disposition de la communauté. Quand nous avons travaillés au musical en patois - j'ai dit qu'il a été le premier, tandis que justement vous me dites qu'il avait eu une expérience à Introd et je le reconnais - et nous avons porté au Théâtre romain le musical en patois et qu'une fille de couleur - de couleur, avec la peau foncée! - a été la protagoniste en patois du musical, dans mon cœur c'était que l'opération culturelle c'était réalisée. Parce que, si on veut faire devenir éternelle une identité, on doit la donner aussi aux autres qui viennent dans notre région et qui ont la possibilité de s'ajouter à nous, en devenant une chose unique. Combien de gens qui sont venus émigrés ici jouent à la rebatta et parlent patois.
Je me permets aussi de dire, quand vous citez les manifestations, que ce sont les seules manifestations ou effectivement on parle encore patois: la batailles des reines et les sports populaires. La batailles des reines et les sports populaires - je vous invite à venir, de temps en temps, aux batailles de reines et aux matchs de rebatta - se sont encore les endroits où, quand le speaker il prend la parole, des fois quelqu'un lui dit: deh, predza co tchequa italien ou français qu'y a coque touriste! [patois, deh, parle un peu d'italien ou de français, parce qu'il y a quelques touristes] On parle patois et je défie quiconque - le collègue Distort l'a bien rappelé - que quand on sort de cette région et on se mesure avec les autres, il n'y a personne qui a la richesse culturelle que la Vallée d'Aoste possède.
Après, je suis d'accord qu'il faut lutter tous les jours. Commençons ici à écrire l'initiative en français, collègue Luboz, à la place de nous la présenter en italien. Commençons à venir ici parler en français dans ce Conseil régional. Commençons, comme dit le collègue Lucianaz, à faire une bataille comme on a fait dans les conseils municipaux de pouvoir introduire aussi le patois, en respectant aussi ceux qui ne le comprennent pas; c'est juste et sur ça vous me trouverez toujours d'accord. Les batailles que la collègue Spelgatti rappelait, sont des batailles qu'on a faites quand on était tout petit! On était en Bretagne étudier le système des écoles de Diwan, pour venir au thème de l'école, que quelqu'un a évoqué. Vous vous souvenez les années de la Jeunesse valdôtaine, où on a lancé la provocation des écoles séparées? Nous avions étudié le modelé de l'immersion linguistique. L'école de Diwan c'est un modèle basque qui a été repris en Bretagne: la langue plus faible est introduite tout de suite par rapport à la langue forte, qui est celle du dominateur, ou quand même de la globalisation. Dominateur c'était Chanoux, mais la globalisation quand même c'est une domination. C'est le glocalisme, c'est être local e global ensemble, c'est de savoir le patois et l'anglais, c'est de savoir le français et l'allemand, c'est de savoir tout ce qui nous lie à nos racines, ou aux racines qu'on a reconnues par amour, par amour de quelqu'un, par amour de sa terre: par amour! Ensemble, avec les éléments de la modernité.
Je veux dire que je partage: on ne doit pas nous diviser et j'arriverai à quelques modifications, si c'est possible, pour avoir un texte partagé. On ne doit pas être folklore et moi je dis qu'il y a des mots qui sont desueti. Annibale Salsa, qui est un grand anthropologue, dit: "ci sono termini desueti, uno di questi è folclore, ma uno di questi è conservatorio". On ne peut pas appeler conservatorio un endroit où on fait de la musique, car la musique c'est progrès. Il y a des mots desueti comme musée: aujourd'hui le musée c'est le musée archéologique, mais on essaie de faire quelque chose de différent quand on fait un centre d'étude ou autre chose. Il y a des mots qu'on doit oublier et le folklore fait devenir quelque chose dans un musée. Alors nous ne devons pas devenir folklores et je rigole des fois, qu'on dit deux mots en français, après on parle pendant six heures en italien: ça c'est, quelquefois, un peu de folklore; c'est du respect aussi, mais c'est quelquefois un peu de folklore.
Pour éviter qu'on aille dans un musée - parce que le jour qu'on fera le musée de la langue morte, comme le latin, ce sera qu'on est mort - moi je crois qu'il y a encore une vivacité entre nous! Le collègue Chatrian a dit qu'ici nous avons 20 patoisants sur 35 et ceux qui ne sont pas parfaitement patoisant peuvent le devenir, ou peut-être n'osent pas trop le parler, simplement parce qu'ils n'ont pas eu la chance ou la possibilité. Nous sommes repartis avec les cours de patois, sur engagement qu'on avait pris ici, avec toutes les limites qu'on peut avoir, mais nous sommes repartis avec les cours de patois. Nous avons travaillé dans les années sur un film documentaire des visages et des mots qui racontait - je l'ai déjà cité une fois - quel est aujourd'hui l'identité valdôtaine. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui se sentir valdotain? Pas il y a cent ans, cinquante ans, parce que sinon on devient rhétorique! On doit être valdôtain aujourd'hui, nos jeunes doivent sortir en étant des glocaux: ils doivent savoir avant tout le patois, connaître le château de Sarre, connaître le musée d'avenue Saint-Martin-de-Corléans, plutôt que toute l'offre culturelle valdôtaine, après aussi le Museo Egizio et après aussi justement tous ce que le monde peut offrir.
Ça c'est le travail dur à l'intérieur de l'école, mais on ne peut pas décharger tout sur l'école! Et non plus tout sur la politique, ou mieux, sur l'administration! Parce qu'on ne peut pas acheter les gens - un jour on pourrait parler de la prime de bilinguisme et faire une belle discussion sur ça aussi! - et on ne peut pas acheter l'amour pour les langues! On ne peut pas imposer aux associations de parler dans une langue: on peut les sensibiliser, et je vous ferai quelques propositions.
Collègue Luboz, on a critiqué le président du gouvernement pendant des années, parce qu'on disait qu'il y avait une certaine centralisation du pouvoir. On demande encore au président de la junte - j'aime bien l'appeler "la junte", comme on disait autrefois - de se mettre là, comme disait le collègue Bertin, à faire une lettre à Roberto Bonin pour lui dire: essaye de parler un peu patois. Moi, à sa place, je répondrais: commencez à le parler vous! Mais pas seulement ici!
On nous l'a enseigné quand on était petit, l'amour on l'a appris, ce n'est pas qu'on nous l'a imposé! Probablement ils nous ont créés des conditions favorables, peut-être on l'avait dans notre cœur, je ne le sais pas. Je l'ai déjà dit une fois, la langue maternelle ce n'est pas la langue de ta maman. Ma maman ne parlait pas patois, elle était francophone et m'a parlé exclusivement français, mais mon père et mon grand-père m'ont toujours parlé patois: moi je pense en patois. Alors, la langue maternelle c'est la langue dans laquelle on pense, ou on se fâche. C'était beau d'écouter les discussions de nos parents, quand ils s'exprimaient dans la langue chacun la sienne, mais il y avait des belles discussions qui faisaient sortir du cœur ou de l'âme celle qui était la réalité.
Les thèmes linguistiques sont délicats et je reviens à dire de ne pas les banaliser, je le dis à tout le monde; je suis très délicat sur ce thème, car cela me passionne. Mais je voudrais citer l'exemple français et Madame Le Pen, comme ça je ne cite personne. La Lega, pas la Lega, la gauche, la droite: je ne cite pas et j'ai profondément de respect pour tous les mouvements politiques.
J'ai bien écouté hier la discussion. Je confirme: le mot carambana existe dans une belle chanson de Cogne, Le vëpre de Cogne. Ce n'est pas vraiment un beau terme à utiliser dans la salle du Conseil, sincèrement! Ma ça existe dans notre patois, au moins dans certains patois, surtout dans cette chanson: "Pa poue maque euna beurta carambana avouë sat gottro..." [patois, Mica solo una brutta carampana con sette gozzi] et c'est une chanson de Cogne qui s'appelle justement Le vëpre de Cogne.
Voix hors microphone.
Je l'ai dit pour pas trop dramatiser certains passages.
Je cite la France, parce qu'il ne suffit pas d'aller le matin sur la tombe de Chanoux et l'après-midi de se mêler avec certains gens. Je respecte profondément ceux qui en Vallée d'Aoste prônent certains arguments qui ont été mis à l'attention de ce Conseil. Mais je vous rappelle ce qui s'est passé en France, où une partie - droite et gauche! -se retrouve dans certaines idéologies qui sont contre la diversité et sont pour l'assimilation, pour reprendre les mots qui ont justement été cites. En France il y avait un instrument qui s'appelait la patoise. Vous savez qu'est-ce que c'était la patoise? C'était un petit objet en bois, que les enseignants devaient utiliser et qui venaient taper sur les doigts de l'enfant qui avait prononcé un mot en patois. Ça c'était les années '70, ce n'était pas 1870, mais 1950, 1960 et 1970: l'enfant été banni de la classe, on lui tapait sur les doigts, il avait la patoise dans la main et il devait garder la patoise jusque au moment ou un autre enfant aurais prononcé un autre mot en patois, en lui tapant sur les doigts. Ça a été anéantir les identités, anéantir le régionalisme - en Italie les régions sont nées en 1970 - mais ça a été l'assimilation et ça a été vraiment anéantir. Il y avait et il y a encore des pancartes en Bretagne: "il est interdit de cracher e de parler breton". Cela pour revenir à nous, en disant que la Vallée d'Aoste dans ces décennies a eu une politique d'ouverture, par rapport même au Tyrol du Sud, là où ils ont décidé d'être eux et nous, ceux qui sont italophones et ceux qui sont germanophones. C'est d'ailleurs la motivation pour laquelle dans certaines vallées et parties du Tyrol du Sud certains mouvements autonomistes ont encore tenue: ils n'ont même pas la télé italienne, ils ont la télé allemande et leur modèle c'est l'Allemagne et l'allemand, un autre modèle. Ici nous avons décidé de faire une autre politique: c'est le plurilinguisme, pas le bilinguisme. C'était le bilinguisme, mais il y a les articles qui ont été cités par quelqu'un et à notre Statut a été ajouté le 40 bis, les fameux articles linguistiques. Nous avons eu la possibilité de nous intégrer, aujourd'hui c'est un patrimoine qui existe et on ne peut pas le nier. Il faut continuer à le défendre, car les défis culturels sont bien présents, mais ce que je veux dire c'est que nous avons la possibilité aujourd'hui tous ensemble de continuer.
D'un côté il ne faut pas banaliser le fait que les langues sont toujours en danger. On parle du walser et surtout du töitschu, qui est une langue qui existe seulement dans une commune, et je crois que c'est un cas unique au monde: il y a une commune qui a une identité territoriale avec une langue.
Je passe au walser e su questa parte mi esprimerò in italiano, anche perché ritrovo dei refusi in una parte del deliberato: si dice di "promuovere l'uso della lingua francoprovenzale/arpitana e la lingua walser" e segue tra parentesi l'indicazione dei comuni; è meglio specificare, perché effettivamente il patois arriva sino a una certa parte e più su hanno la loro lingua, che è il walser. Volevo ricordare solo due cose sui walser. Innanzitutto, negli anni sono state fatte delle operazioni culturali per salvaguardare le piccole scuole di montagna perché, al di là della famiglia, del centro culturale walser e di altre entità, quella sulla scuola è stata un'operazione che ha dato la possibilità di salvaguardare queste lingue, vista l'impossibilità di avere l'apertura di scuole in deroga ai parametri nazionali. Il fatto di riuscire oggi a conservare il walser è passato attraverso varie iniziative. Penso al Projet Popon, penso al potenziamento della lingua tedesca nelle scuole con insegnante di titsch e di töitschu aggiuntivo, con la possibilità di favorire tutto ciò che era identità. Bisogna sicuramente fare degli sforzi, perché quelle piccole comunità, minoranze nella minoranza, come qualcuno le ha citate, sono ancora più difficili da difendere.
Collègue Luboz, ce que je voulais proposer à l'attention aussi des collègues, car il y a déjà des propositions d'amendements de la part du collègue Vesan, c'est que moi je crois et nous croyons que le Conseil ne doit pas engager le Président du gouvernement simplement, mais doit engager l'Administration, ou les institutions. En disant peut-être institutions nous engageons toutes les institutions valdôtaines, dans le sens le plus ample du terme, c'est-à-dire qu'il y a ce Conseil, il y a les conseils municipaux, les codifications culturelles de notre patrimoine matériel et immatériel, les sociétés... il y a tout le monde. Nous disons, donc, d'être un peu plus générique par rapport à engager le Président du gouvernement. La proposition serait "il Consiglio regionale, impegna l'amministrazione" o "le amministrazioni" o "le istituzioni a proseguire nella promozione", peut être "proseguire e intensificare" si on veut justement mettre quelque chose en plus, "proseguire ed intensificare l'uso della lingua francoprovenzale/arpitana", là je mettrais "su tutto il territorio" pour diviser le walser "e la lingua walser nei comuni di Gressoney-Saint-Jean, Gressoney-la-Trinité e Issime". En reprenant certaines interventions, qui ont demandé "pourquoi on parle seulement des manifestations?", on propose une ligne d'action un peu plus générale, en disant justement "su tutto il territorio" e "la lingua walser nei comuni di Gressoney o nelle terre walser", sans mettre les manifestations, mais en mettant "sensibilizzando l'utilizzo delle lingue storiche e veicolari nella comunità". Cela pour dire, en général, d'intensifier, dans le sens qu'après chacun de nous auras la possibilité de travailler pour faire intensifier, pour solliciter, surtout pour ne pas donner l'impression que nous allons faire un discours de régime - le régime impose la langue, que ce soit une langue ou l'autre - mais pour qu'il y ait la possibilité, même d'un point de vue psychologique, de dire: bien, redevenons ou continuons à être orgueilleux de nos langues, en intensifiant les mesures pour favoriser l'utilisation de ces langues qui sont patrimoine de notre communauté. Après on peut s'arrêter un moment pour écrire un peu mieux le texte, mais j'ai essayé aussi de mettre ensemble les différentes interventions, en laissant les prémisses telles qu'elles sont. Je crois que sur les prémisses tout le monde a dit, mais c'était plutôt l'engagement.
Je conclue, collègues, en reprenant l'eundrimeuia [patois, addormentamento], qui est le risque qu'une communauté, ou que les communautés en général ont quand on parle de langue par rapport à d'autres thèmes: la modernité et tous les thèmes d'actualité qui nous prennent. L'eundrimeuia a fait partie des années '70 et '80: je rappelle souvent le notaire Bastrenta qui avait fait ses belles batailles. Vous souvenez les affiches avec le boulon qui entrait dans la tête du valdôtain, ou Ommo, sù dé téra [patois, uomo, alzati su da terra], qui était devenu un peu le manifeste arpitan et qui avait vu après un mouvement. Nous avons fait d'ailleurs un beau film documentaire, que j'invite à visionner, sur les écoles walser, intitulé Des visages et des mots. Nous avons réalisé un film documentaire de Christiane Dunoyer, Harpitanya, la ferveur d'une idée - nous avions présenté Louis de Jarriot, que quelqu'un a cité hier, avec les trente ans de l'autonomie - qui en effet reparcourt aussi des émissions télévisées de la télévision nationale, qui disaient: ci sono dei movimenti giovanili in Valle d'Aosta di giovani che dicono che non bisogna vendere la terra e bisogna rimanere proprietari, "maîtres chez nous"; cela est intéressant dans la mesure où l'on dit que l'eundrimeuia a été réagi par des jeunes de l'époque.
Ma considération finale c'est que la politique est arrivée après, c'est à dire que dans ces années-là la politique était engagée sur d'autres choses. Ce sont les mouvements et les centres culturels, qui d'ailleurs après ont représentés le système bibliothécaire valdôtain (Saint-Pierre, Châtillon notamment, mais pas seulement), c'était la musique populaire, c'était le théâtre populaire. La politique, les mouvements politiques, certains mouvements politiques ont su incarner ce sentiment populaire et après un boom aux élections ont amenées dans les institutions certaines instances, qui en effet ont été menées avec des sensibilités différentes; évidemment quelques administrateurs étaient plus sensibles, d'autres moins. Cela pour dire que les institutions sont la garantie pour nous tous que les choses continuent à exister, mais hors de ce palais et hors des institutions c'est là qu'on doit faire le grand travail, c'est là que chacun de nous doit s'engager quotidiennement, afin que cette langue puisse continuer à exister et que dans chaque occasion ont ait la possibilité, en respectant aussi ceux qui n'ont pas la chance de la savoir, d'être orgueilleux d'avoir ce patrimoine culturel.
Dans ce sens je remercie toutes les interventions. Je crois, nous croyons, que si nous faisons front commun sur ce thème nous serons beaucoup plus forts, par rapport à ceux qui ont l'intention de mettre des étiquettes sur un thème qui est transversale et qui est surtout des valdôtains et pas de certains mouvements.
Président - La parole à l'assesseur Certan.
Certan (AV) - Merci, collègue Luboz, pour la présentation de cette initiative qui, quand même avec ses nuances différentes, a soulevé un thème sûrement très important et l'a porté au Conseil régional. Après l'intervention de l'assesseur Viérin, moi aussi je dis qu'il est un thème encore très vif, et je le remercie parce qu'il a su faire vraiment une synthèse et un excursus historique très intéressant.
C'est vrai, la perte d'une langue porte en soi la perte d'une identité et la perte d'une culture. Je dirais que la perte d'une langue, d'une identité et d'une culture porte sûrement un peuple à l'appauvrissement. Laurent Viérin a rappelé les finesses d'une poétesse valdôtaine qui avec les mots a su chanter vraiment des passages de l'identité valdôtaine très intéressants. Il a cité Magui Bétemps et un passage ou elle disait "pour chaque culture qu'on méprise toute l'humanité aura perdu quelque chose, même la plus petite". Elle avait dans ses mots une finesse très particulière et je voudrais vous rappeler quelques mots d'une chanson qu'elle chantait: "l'oiseau ne chante plus, il faut le libérer, l'oiseau ne chante plus, l'oiseau et prisonnier, il faut le libérer, lui rendre le plein air pour chanter le bonheur d'être maître chez soi". Après un autre passage était: "un géant pour voisin - la Vallée d'Aoste a un géant pour voisin - qui lui jeta un sort qui lui fit perdre son chemin". Voilà, je pense que dans ces années-là Magui Bétemps avait vraiment résumé une chose qui est encore très actuelle: souvent nous avons des géants pour voisins, mais nous ne les reconnaissons pas. Nous pensons qu'ils sont des amis qui sont là pour nous caresser, mais ils nous plumeront. Ils ne caresseront pas l'oiseau, ils le plumeront et le laisserons sans plumes et sans identité.
Donc, je suis d'accord qu'il ne faut pas aller vers une standardisation et une homologation, parce qu'elles nous rendraient tous plus pauvres. Par contre, je me permets de dire que je ne suis pas d'accord que nous avons été tous des complices. Les valdôtains, même dans cette salle, n'ont pas été tous des complices. Quelqu'un peut-être a trompé, peut-être même dans les politiques linguistiques. Dans les années on a fait peut-être des fautes et peut-être le corps enseignants doit encore plus être sensibilisé et comprendre. À ce propos je voudrais vous raconter que, il y a un mois, j'ai participé à un colloque avec un professeur de l'université en Sicile, à Palerme. En Sicile, pour la prochaine année scolaire 2019-2020, ils sont en train de parler d'un patrimoine qui ont presque perdu, qui est vif dans le territoire, mais qui d'un point de vue par exemple des écrits a beaucoup perdu. Cependant il a été récupéré surtout par la partie élitaire de la culture, parce que les professeurs et la partie élitaire ont compris cet aspect que Magui chantait. Si on perd un patrimoine linguistique on perd les nuances, on perd la couleur, on perd les saveurs, on perd les parfums du territoire. Alors ils sont en train, pour la prochaine année, de l'insérer dans les lycées en Sicile d'une façon expérimentale, parce qu'ils ne sont pas encore à même de la proposer dans toutes les écoles. Et il y a beaucoup d'enseignants qui ont compris cet aspect et qui nous disent: vous avez de la chance, parce que vous n'e l'avez pas perdu dans les petits, vous.
C'est vrai, on ne l'a pas perdu dans les petites classes et dans les classes enfantines, mais sûrement - l'assesseur Viérin l'a très bien dit - il faut le relancer lui donnant un nouvel élan, parce que ça ne suffit pas de l'insérer dans les petites classes. Là je suis d'accord qu'il faut se parler et se donner aussi des priorités. La famille et la société sont sûrement celles qui doivent le parler, s'ils veulent que nos langues restent, parce que on ne peut pas dire aux autres qu'il faut maintenir le patois, mais parler à ses enfants en italien. Ça c'est malheureusement ce qui est arrivé dans certaines familles valdôtaines. J'aime dire une anecdote que maman me racontait toujours: il y avait une dame qui lui reprochait toujours de parler à nous, à moi et à ma sœur, en patois, parce que nous aurions eu des difficultés à l'école et alors elle parlait en italien a ses enfants. Elle, à ce moment-là, en s'adressant à son chien lui a dit: vieni, vieni, su andiamo! Alors maman lui a dit: excusez-moi Madame, vous parlez italien à votre chien pour qu'il soit plus à l'aise à l'école? Voilà, pour dire que quelque fois il faut de la culture pour reconnaître qu'une langue est nuance, est parfum, est sensation, est émotion, est territoire.
Il faut de la culture et ça c'est peut-être ce que quelquefois on a perdu dans les institutions. Il a été oublié, ou on a pensé qu'il n'était plus ci important, ça dans l'école aussi, peut-être, mais on a quand même su le maintenir. Il a été très bien dit et je ne le répète pas, parce que les passages que l'assesseur Viérin a fait ont étés très ponctuels: nous sommes quand même une des régions qui peuvent encore dire de l'avoir vif et actif. Je vous assure que dans ma famille quelquefois j'ai des leçons de la part des générations plus petites, parce qu'ils me disent: maman, mais pourquoi tu t'adaptes et tu parles en italien, quand c'est important de transmettre notre langue. Donc je pense qu'il faut écouter aussi les générations petites, parce que les jeunes générations savent ce que nous avons transmis. Je me permets de dire que l'identité d'un peuple on ne la transmet pas en donnant des sermons. L'identité d'un peuple ne se transmet pas en choisissant des arguments qui sont populistes ou qui plaisent au peuple, parce que il y a des moments où peut-être il y a des arguments qui plaisent et qui reviennent à la une et alors on les choisit. J'ai bien apprécié votre intervention parce qu'elle n'était pas, comme d'autres, de cette part-là, mais elle était d'un autre côté, donc je l'ai beaucoup apprécié, cher collègue.
Je disais que la famille a un rôle principal, mais sûrement l'école a son rôle très important et je dirais qu'il faut l'actualiser - je suis d'accord avec ce que l'assesseur Viérin a dit - parce qu'autrement il reste quelque chose de mort. J'aime là faire un passage que Alexis Bétemps a fait par rapport au carnaval. Il dit que le carnaval en Vallée d'Aoste c'est une tradition et une des fêtes encore les plus actuelles et, tout compte rendu, aussi entre les plus représentatives. Elles vraiment sont passées, sono state tramandate (dal latino: tradere), donc ont été passées aux générations. Il dit qu'elles sont passées parce qu'elles se sont transformées. Si elles ne s'étaient pas transformées, elles auraient été figées dans un moment historique et elles n'auraient pas passées. Les langues se transforment, la culture, les manifestations aussi, les fêtes se transforment. Monsieur Distort, nous ne sommes pas nous à le dire, mais ce sont les linguistes, ce sont les sociologues, ce sont les étudiants, les écrivains qui disent ces choses. Je dirais aussi que nous n'avons pas inventé aujourd'hui, avec ce débat, l'eau chaude, car c'est quelque chose de laquelle on a toujours parlé.
Enfin, je voudrais revenir aussi sur le rôle des social ou de la télé, parce qu'il est fondamental, malheureusement. L'appauvrissement et l'aplatissement culturel que nous avons eu c'est aussi une question d'écoute, de pourcentage: si pendant toute la journée on n'a qu'une langue qui passe, c'est inévitable la standardisation. C'est inévitable qui il passe un message qui n'est pas passé à travers des messages écrits ou parlés, mais qui passe avec l'exemple, et les enfants et les petits c'est inévitable qu'ils pensent que cette langue-là soit importante. Voilà donc qu'il faudrait faire des réflexions et nous les avons faites dans ce Conseil pendant l'autre législature. La réflexion par exemple sur les nouvelles télévisées: c'est une réflexion à ouvrir, à rouvrir.
Je disais que la langue transmet un territoire, parce qu'elle transmet des émotions. Le disait bien le collègue Viérin: souvent on parle dans la langue maternelle quand on est fâché, ou quand on est très heureux, parce que sont les opposés des émotions. Donc, on ne peut pas comprendre les nuances, le sfumature, d'une langue si on ne la sait pas et on ne la parle pas.
J'ai entendu parler aujourd'hui de diversité et qu'on respecte la diversité. La diversità on la respecte en la pratiquant, pas seulement en la disant. Il y a un dicton très connu et qui est figé dans la culture valdôtaine: "bien faire et laisser dire". Souvent on entend vraiment cavalcare delle onde, mais après on ne les voit pas dans les faits. Il faut être, à mon avis, très ancré au thème.
Enfin, un autre passage sur l'initiative que sûrement, comme il l'a dit Monsieur Viérin, nous estimons intéressante, avec peut-être des nuances quelques peux différentes. J'ai participé à Issime à l'assemblée générale du Comitato unitario delle Isole linguistiche storiche germaniche in Italia et ça a été très intéressant. Les thèmes traités sont liés sûrement à la défense des langues minoritaires et surtout d'une langue qui est minoritaire dans un territoire où il y a d'autres langues minoritaires. C'est là, je crois, le grand respect de la diversité et il a été très intéressant. Les trois communes étaient concernées et l'assesseur Viérin m'avait chargé de participer à cette assemblée. Pour la première fois il y a eu la participation d'une représentative de la Suisse, car dans les vallées du Canton Ticino il y a des îles germanophones. Ils sont en train de faire réseau, ça c'est l'autre chose importante: peut-être nous parlons des différentes langues, mais on peut faire réseau. Sur ça je crois que nous serons ici pour accueillir toutes les propositions et pour travailler ensemble sur des projets dans les écoles, dans les associations, dans tous les domaines, parce que je pense que nous avons le même objectif de maintenir une identité, une culture et des langues.
Dalle ore 11:59 assume la presidenza la presidente Rini.
Rini (Presidente) - Per l'illustrazione della proposta di emendamento, la parola all'assessore Viérin.
Viérin (AV) - J'ai essayé d'écrire le texte en prenant les différentes parties dont on a parlé. Ce serait la proposition et après on peut en discuter: "impegna l'amministrazione a proseguire e intensificare l'uso della lingua francoprovenzale/arpitana su tutto il territorio regionale e la lingua walser nei comuni della valle del Lys, sensibilizzando la comunità e il tessuto sociale - de cette façon on comprend la ruralité, le tourisme... - a utilizzare le lingue storiche della Valle d'Aosta" ou "a utilizzare maggiormente le lingue storiche della Valle d'Aosta".
Presidente - La parola al collega Luboz.
Luboz (LEGA VDA) - Le débat a été long, signe que l'attention sur ce sujet est bien présente dans cette salle et je me réjouis de cela. Je crois que nous n'avons aucun problème à accepter les propositions de Monsieur l'assesseur Viérin. Si possible, peut être ajouter aussi les administrations communales, les administrations locales, invitées afin...
Voix hors microphone.
À bien, alors j'avais oublié quelque chose.
Je tiens seulement à souligner que dans le petit texte poétique que j'avais récitée, le "ils" il faut le recadrer en "nous", parce que c'est nous les principaux responsables, si nous analysons la difficulté, le cri d'alerte que j'aimerais souligner envers la situation linguistique de notre région. Mais bon, je me réjouis de l'accord et je prends acte du petit reproche que vous me faites sur l'inscription des motions en langue française, mais je vous dirais de faire le petit reproche aussi à votre président, qui a défini le français langue cadavre.
Presidente - La parola all'assessore Viérin.
Viérin (AV) - Seulement pour une précision. Je crois que chacun de nous répond pour soi-même. Je n'ai pas de président, dans le sens que je n'ai pas compris à quel président vous vous référez. Au-delà de ça, commençons à répondre pour nous-mêmes.
Presidente - Chiedo di depositare il testo modificato, proposto dall'assessore Viérin.
On ferme la discussion générale. La parole pour déclaration d'intention au collègue Bertin.
Bertin (RC-AC) - Come detto in precedenza, non si può che essere favorevoli alla diffusione e al mantenimento della lingua francoprovenzale e del walser. Ovviamente non sarà con questo strumento che risolveremo la questione che, anche in relazione agli interventi che sono stati fatti, mi sembra sempre più legata alla volontà di mettersi una medaglietta sul petto, ma in realtà le cui conseguenze pratiche sono riconducibili a zero. Mi pare che questo argomento importante abbia bisogno di un altro approccio e di strumenti più efficaci, piuttosto che queste tre ore di discussione in Consiglio.
Présidente - La parole au collègue Luboz.
Luboz (LEGA VDA) - Seulement parce que j'avais oublié dans la déclaration d'acceptation des modifications proposées par l'assesseur Viérin, aussi de prendre acte des suggestions faites par le représentant du Mouvement 5 Étoiles, Monsieur le collègue Vesan, donc enlevant les événements organisés par les Proloco, si pas à leur initiative, naturellement.
Présidente - On peut procéder donc à la votation. La votation est ouverte. La votation est close.
Résultat du vote:
Présents, votants et favorables: 35
Le Conseil approuve à l'unanimité.