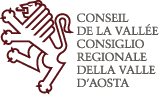Oggetto del Consiglio n. 2820 del 10 novembre 1997 - Resoconto
SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 10 NOVEMBRE 1997
OGGETTO N. 2820/X Illustrazione delle leggi di bilancio per il 1998.
Président Maintenant, comme on avait trouvé l'accord dans le Bureau de la Présidence, on passe à l'examen des points 26 et 27 à l'ordre du jour. La parole au rapporteur, Conseiller Rini.
Rini (UV) Du point de vue administratif et politique, le budget régional est l'acte le plus important que le Conseil approuve chaque année et le débat y afférent représente un moment capital et délicat pour cette Assemblée et pour la Communauté valdôtaine tout entière.
Nous allons adopter le dernier document programmatique de la Xème législature: le budget 1998 revêt donc une plus grande importance par rapport aux budgets précédents, car il nous permet de comprendre si cette majorité a respecté ou non l'ambitieux programme qui avait été approuvé en 1993.
Nous franchirons bientôt la ligne d'arrivée: nous pouvons et nous devons évaluer nos choix pour établir s'ils ont été corrects et surtout si la collectivité valdôtaine dans son ensemble a pu en tirer profit.
J'estime que ce budget - qui a été, entre autres, présenté à l'avance par rapport aux années passées - réfléchit les choix qui ont été aux cours des années précédentes; en effet, il se place sous le signe de la continuité, il est cohérent avec le programme que ce Conseil a approuvé au début de la législature, il est adéquat aux ressources, il est réaliste et vise la réduction des dépenses de fonctionnement de la machine administrative; il s'agit d'un budget qui accorde une attention particulière aux couches faibles de la population, aux collectivités locales et, tout comme les budgets précédents, au rôle capital de l'homme.
La rapidité avec laquelle le Gouvernement a présenté ce document comptable permet d'attribuer aux différentes structures de direction les ressources qui leur sont destinées et dont elles pourront disposer dans de brefs délais, de manière à ce que les objectifs de gestion prévus soient atteints.
Il appert de l'analyse de budget que les restes à recouvrer font l'objet d'une légère diminution par rapport à l'année précédente, mais que le recouvrement par la Trésorerie des sommes dues à la Région s'avère encore difficile.
En ce qui concerne les restes à payer, une légère hausse est à remarquer: à la date du 1er janvier 1998, ils s'élèveront à 998.600 millions de lires, ce qui témoigne une fois de plus du fait que l'Administration régionale connaît encore des difficultés pour ce qui est des dépenses, surtout dans les secteurs pour lesquels les procédures s'avèrent nécessairement moins rapides que celles relatives aux dépenses courantes.
Quant aux recettes, il y a lieu de souligner, d'une part, la consolidation des ressources propres, d'autre part, la diminution progressive des virements de l'Etat: au titre de 1998, ces derniers représenteront 25 pour cent du total des recettes et s'élèveront à quelque 500 milliards de lires, soit une somme inférieure de 140 milliards à celle nécessaire pour la couverture des dépenses (640 milliards) qui, dans d'autres régions, sont supportées par l'Etat.
L'action politique et administrative de ces dernières années s'est avérée positive et la collectivité a pu et a su tirer profit et une richesse accrue, qui entraîne une augmentation des recettes du fait des taxes et des impôts; si elles sont gérées d'une manière responsable et sérieuse, ces recettes peuvent engendrer de nouvelles opportunités de croissance non seulement économique, mais aussi culturelle et sociale, ce qui ne manquera pas de faciliter l'affirmation de notre identité.
En ce qui concerne les dépenses, qui s'élèvent a 2.788.200 millions de lires au titre de 1998, il y a lieu de remarquer qu'une somme équivalant à plus de 63 pour cent du total est destinée à la couverture des dépenses courantes, dont plus de 51 pour cent est représenté par des frais qui dans d'autres régions sont financés par le budget de l'Etat: santé, transports publics, fonctions préfectorales, protection civile, service forestiers, dépenses courantes des collectivités locales, personnel enseignant, pensions d'invalidité, services de lutte contre les incendies et entretien des anciennes routes nationales.
Par conséquent, les ressources pouvant être utilisées pour de nouvelles actions sont de plus en plus exiguës, étant donné la réduction progressive des crédits dont l'Administration régionale peut disposer librement, en raison des trop nombreuses dépenses obligatoires et incompressibles.
Le montant des fonds globaux inscrits au budget 1998 s'élève à 73.422 millions de lires; ces fonds sont destinés pour la plupart à des interventions à caractère institutionnel et au développement du système économique.
Il importe de souligner que l'Administration entend poursuivre le chemin de la sobriété et de la rigueur afin de continuer à économiser, où cela est possible, sur les frais de fonctionnement de la machine administrative: au titre de 1998, une diminution équivalant à 27 pour cent desdites dépenses est prévue, qui touchera notamment l'attribution de missions et de fonctions de consultation, les déplacements, les colloques, les manifestations et le parc automobile.
Si dans certains secteurs il a été pertinemment décidé de réduire les dépenses, dans d'autres secteurs - tels que la santé, la culture, les collectivités locales et l'assistance en faveur des couches faibles de la population - les investissements seront par contre plus importants, conformément à la volonté de cette Assemblée de mettre l'homme et ses besoins essentiels au centre de l'action politique et administrative.
Fatte queste premesse passerei ad esaminare sinteticamente le disposizioni più significative contenute nei documenti programmatici.
Si prevede per il triennio 1998/2000 entrate e spese per complessivi 8.371.500 milioni di lire di cui 2.788.200 milioni relativi al 1998, 2.800.800 milioni per il 1999 e 2.782.500 milioni per l'anno 2000, come specificato nell'allegato B.
Si evidenzia una flessione del tasso di crescita reale per gli anni 1999 e 2000 dovuto principalmente al fatto che non sono stati inclusi i trasferimenti statali o comunitari che saranno approvati nei prossimi mesi e non ancora accertabili, mentre sono state valutate con molta prudenza le entrate derivanti dall'introduzione dell'IRAP che lascia ancora alcune incognite.
Nell'allegato A sono riportate le autorizzazioni, in distinti articoli, per i nuovi limiti di impegno per l'anno 1998, nuovi impegni che riguardano il concorso nel pagamento di interessi su mutui nei settori dell'artigianato, della produzione di energia elettrica, dell'agricoltura, del diritto allo studio, del turismo e dell'edilizia residenziale.
Vengono determinate le spese per l'acquisto di beni immobili per fini istituzionali, per lo sviluppo del settore industriale, per la realizzazione di opere pubbliche e per l'acquisizione di terreni da destinare ad aree protette.
Si definisce la pianta organica dell'Amministrazione regionale prevedendo l'abolizione - fatti salvi i diritti maturati al 31 dicembre 1997 - del "trattamento di cessazione del rapporto di impiego" previsto dalla legge regionale n. 3 del 1956.
Si determina l'ammontare da destinare al settore della finanza locale garantendo risorse adeguate alle necessità, introducendo dei correttivi che possano reintegrare le minori entrate legate alla soppressione di alcune imposte comunali e con l'introduzione del comma 4 dell'articolo 6 di stimolare un maggior controllo da parte dei comuni per quanto riguarda il pagamento dell'ICI.
A questo proposito è da evidenziare il fatto che, mentre nel resto d'Italia diminuiranno le entrate degli enti locali, nella nostra Regione continuerà la crescita delle stesse per cui i trasferimenti saranno più di 1.000 miliardi nel triennio 1998/2000 di cui 320 miliardi per il 1998 con il 45 percento senza alcun vincolo di destinazione.
Si prevede la spesa di 2 miliardi per l'attivazione nel 1998 di un piano lavori di pubblica utilità al fine di assicurare ulteriori possibilità di impiego per chi ha la sfortuna di trovarsi in situazione di difficoltà o di svantaggio.
Viene determinata per l'anno 1998 una spesa di lire 226.380 milioni per il finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di adeguamento tecnologico. Per il triennio 1998/2000 è prevista la spesa di lire 82.057 milioni di cui 25.857 milioni per il solo 1998 per la realizzazione di opere urgenti di ripristino e manutenzione straordinaria di strutture ospedaliere.
Per quanto concerne la formazione professionale, si prevede per il 1998 l'impegno di 14.422 milioni. Nel settore dei trasporti si rideterminano le spese per interventi nel trasporto collettivo di persone, per i contratti di servizio, per la riqualificazione della linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier, per la realizzazione del collegamento Cogne-Charemoz-Plan Prà e per il potenziamento dell'Aeroporto.
Importanti interventi in materia di agricoltura e zootecnia saranno possibili con la rideterminazione delle autorizzazioni di spesa per aiuti alle aziende agricole e zootecniche, con particolare attenzione alle aziende che mantengono la qualifica di "ufficialmente indenni".
Si prevedono importanti investimenti per quanto concerne l'istruzione e la cultura, in particolare per la stipula di convenzioni con università onde consentire la formazione dei docenti, per interventi di edilizia scolastica e per il completamento dei lavori di sistemazione del Museo di Gressoney-Saint-Jean.
Nel settore del turismo si investirà maggiormente nella promozione che sarà diversificata e tendente a sollecitare le presenze nei periodi estivi e cosiddetti "morti" e si interverrà a favore delle guide ed aspiranti guide alpine. Per lo sport si prevede la realizzazione di infrastrutture di interesse regionale e per la pratica dello sci agonistico.
Importante sarà l'investimento previsto per lavori di ammodernamento e sistemazione della strada dell'Envers per i quali sono previsti lire 4.960 milioni per il 1998, 6.730 milioni per il 1999 e 8.470 milioni per il 2000. Rilevante l'autorizzazione alla spesa per riqualificare e sviluppare l'area industriale "Cogne" di Aosta, per la partecipazione al Fondo sociale per l'emergenza abitativa e per la concessione ad enti pubblici di contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
In conclusione, ritengo che questo bilancio che è il documento strategico che condurrà la Valle d'Aosta al terzo millennio è, come quelli precedenti, realistico e prevede interventi adeguati a quelle che sono le risorse, non è un libro dei sogni, come qualche Consigliere ripete ogni anno, ma uno strumento basato sulla realtà e teso allo sviluppo del sistema economico.
Se qualcuno dirà, come negli anni precedenti, che questo bilancio non contiene grandi cambiamenti rispetto ai precedenti e che è un "déjà vu, déjà entendu", ammetterà che questa maggioranza ha rispettato gli accordi e le promesse fatte ai Valdostani nel 1993 rispettando l'ambizioso accordo di programma che, all'insegna della coerenza e continuità, ha saputo portare avanti agevolando la crescita economica della nostra Regione, favorendo il consolidamento delle proprie risorse e facendo si che la Valle d'Aosta sia sempre meno dipendente dallo Stato, tutt'altro che una Regione assistita.
Concludo dicendo che il bilancio che stiamo per approvare, per quanto ho cercato di evidenziare, è l'ultimo tassello di un'azione politico-amministrativa che ha dato la possibilità di crescita economica, culturale e sociale alla Valle d'Aosta e che la proietta verso una sempre maggiore autonomia finanziaria.
Presidente Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Viérin Dino, Assessore ad interim al bilancio, finanze e programmazione.
Viérin D. (UV) Avant de vous présenter le rapport du budget 1998 et du budget pour le triennat 1998-2000, permettez-moi de remercier tous ceux qui, par leur engagement, disponibilité et collaboration ont permis la présentation de ce budget. Tout d'abord, les dirigeants et les employés de l'Assessorat des finances et du budget, de la Présidence du Gouvernement et également la collaboration du Centro Sviluppo; ensuite le Secrétaire particulier de l'Assesseur aux finances; la IIème Commission permanente du Conseil avec le Conseiller rapporteur et la C.R.E.L. qui a exprimé son avis.
Même avec les innovations qui le caractérisent, le budget de la Région pour le triennat 1998-2000 représente la continuité par rapport aux budgets préparés par ce Gouvernement et pour ce qui est des délais de présentation - près de deux mois d'avance par rapport à la clôture de l'année financière - ainsi que pour sa méthodologie et parce qu'il se veut un document simplifié et clair, facile à lire et à interpréter.
Toutefois, par rapport aux précédents, le budget que nous présentons aujourd'hui revêt une importance particulière du fait qu'il va de pair avec une législature en voie de conclusion et que la Vallée d'Aoste s'achemine vers le troisième millénaire.
C'est ainsi que, tout en respectant les objectifs que nous nous étions fixés et en plaçant encore la personne humaine - et ses exigences - au centre des attentions et des choix politico-administratifs, nous nous apprêtons à compléter la réalisation des orientations indiquées dans le programme politique de législature en juillet 1993.
Et nous le faisons en regardant vers le futur, car à notre avis ces réalisations ne doivent pas simplement être vues comme l'achèvement d'un projet; elles constituent aussi les fondements de notre avenir de Valdôtains. L'avenir d'un peuple, d'une communauté liée à ses traditions, mais moderne et dynamique, qui a su valoriser les spécificités linguistiques et culturelles qui la caractérisent tout comme son autonomie, qui a voulu réorganiser son administration publique, régionale et locale et dont les choix ont permis de faire face à la récession économique générale.
Cette année encore, le document de programmation financière est fondé sur les ressources programmées lors du précédent triennat, ressources effectivement disponibles qui considèrent par ailleurs, dans les limites du possible, les effets potentiels de la réforme fiscale en cours, permettant au Gouvernement valdôtain de poursuivre la réalisation des objectifs préalablement fixés et, en particulier, de consolider le processus de création du système valdôtain des autonomies.
Ainsi, le budget constitue l'instrument essentiel de programmation à moyen terme de l'activité régionale, l'élément de définition des priorités et de la sélection des initiatives, la synthèse entre les actions à réaliser et les ressources financières disponibles.
Il est le document principal de prévision auquel se rattachent les objectifs, les instruments de vérification et de contrôle; il est le moyen nécessaire pour traduire dans la pratique quotidienne les choix organisationnels définis par le budget de gestion.
Et c'est précisément dans le budget de gestion - issu de la réorganisation de l'Administration régionale définie par la loi n° 45 de 1995 et mise intégralement à exécution à partir du 1er juillet de cette année - que se consolide la méthodologie de programmation amorcée les années précédentes par:
- la prévision des ressources financières disponibles pour le triennat;
- la sélection des objectifs - et des interventions à réaliser - de la part du Gouvernement;
- la préparation du budget suivie de son approbation par le Conseil régional;
- la préparation et l'approbation du budget de gestion par le Gouvernement avec attribution aux structures de direction des quotes-parts de budget de leur pleine compétence et détermination des quotes-parts à engager, par contre, sur délibération du Gouvernement.
L'évolution de la méthode de préparation, de la gestion et du contrôle du budget est par ailleurs étroitement liée à la réforme de l'Administration régionale, conçue comme une organisation moderne qui, au moyen de la gestion par objectifs et de la privatisation du rapport de travail, vise à l'efficacité et à l'efficience et se veut plus transparente, plus accessible au citoyen.
Une Administration régionale renouvelée dans sa structure et dans ses mécanismes de fonctionnement, fondée sur la répartition entre les fonctions politiques attribuées aux élus et les fonctions de gestion confiées aux structures et aux dirigeants donc sur les principes d'autonomie et de responsabilité: autonomie dans la gestion et responsabilité dans l'obtention des résultats.
Examinons tout d'abord le contexte économique de référence, en partant de l'Union européenne et de la scène internationale.
La phase d'expansion que connaît l'économie mondiale depuis 1995 devrait se maintenir en 1998: cette croissance marquée, qui ne génère pas d'inflation, devrait donc se poursuivre, soutenue par la nette reprise des Etats-Unis et des Pays anglo-saxons, en général, ainsi que du Canada et du Japon.
Dans l'Union européenne, on a enregistré en 1997 une tendance généralisée à l'expansion, qui est stimulée par l'augmentation des exportations et influe positivement sur la demande interne, sans toutefois avoir eu de répercussions significatives, contrairement à ce que l'on espérait, sur la réduction du taux de chômage. Celle-ci est entravée tant par la conjoncture économique des pays membres, engagés dans des politiques de rigueur visant le rétablissement de l'équilibre budgétaire, que par le manque de flexibilité du marché qui n'est pas en mesure d'absorber l'accroissement de la population active.
Pour les Pays de l'Union européenne, l'expansion devrait se poursuivre en 1998, à la faveur de la construction de l'Union économique et monétaire et des conditions qui y sont liées: à savoir, la convergence progressive des taux d'intérêt, le contrôle de la dynamique de l'inflation ainsi que la stabilité des taux de change jusqu'à la mise en place de la monnaie unique, l'Euro.
C'est précisément en 1998 que commencera la première phase du processus d'introduction de l'Euro avec l'établissement de la liste des pays faisant partie du premier train, qui satisfont à ce que l'on appelle communément les paramètres de Maastricht, c'est-à-dire:
- un taux d'inflation qui n'excède pas de plus de 1,5 pour cent la moyenne des taux des trois pays à l'inflation la plus basse;
- des taux d'intérêt à long terme qui ne dépassent pas de plus de 2 pour cent la moyenne des trois pays aux taux les plus bas;
- un déficit public inférieur à 3 pour cent du produit intérieur brut;
- un endettement public qui ne dépasse pas 60 pour cent du PIB;
- la participation au mécanisme de change du système monétaire européen pendant les deux dernières années.
La deuxième phase commencera le 1er janvier 1999 par la fixation irrévocable des taux de change des monnaies des Etats membres, les unes par rapport aux autres et par rapport à l'Euro. Durant la période de transition - de 1999 à la fin de 2001 - l'Euro sera considéré comme une unité de compte et pourra être utilisé comme monnaie scripturale (chèques, cartes de crédit, virements bancaires, etc.), mais ne circulera pas encore sous forme de billets de banque. Au cours de cette phase, les particuliers pourront l'utiliser dans leurs rapports avec des administrations publiques, même si celles-ci devront continuer à tenir leur comptabilité dans la monnaie de l'Etat dont elles relèvent.
Le début de la troisième phase est prévu pour le 1er janvier 2002. Celle-ci nous amènera à l'introduction définitive de la monnaie unique et donc à la circulation pratique de l'Euro, sous forme de billets et de pièces de monnaie, ainsi qu'au remplacement progressif par l'Euro des monnaies des différents Etats qui cesseront d'avoir valeur légale le 1er juillet 2002. Tout paiement, comptabilité ou budget devra alors être chiffré en Euro.
La Monnaie unique sera donc lancée le 1er janvier 1999 et la Banque centrale européenne, dont le Comité exécutif sera nommé en juillet 1998, sera responsable de la politique monétaire de l'Union européenne.
La mise en place de l'U.E.M. est d'ailleurs, à long terme, la condition nécessaire pour un bon fonctionnement du marché unique, au sein duquel l'adoption d'une monnaie unique ne pourra qu'ajouter une nouvelle dimension essentielle à la liberté de mouvement dont jouissent aujourd'hui les personnes, les capitaux, les biens et les services.
Dans cette optique, la réussite de ce processus présente un intérêt tout particulier pour la Vallée d'Aoste qui, forte à la fois du bilinguisme français/italien qui la caractérise et de sa position géographique, peut trouver dans cette évolution de nouvelles possibilités d'essor, en particulier dans le cadre des relations et des échanges avec les différentes réalités transfrontalières.
La réalisation intégrale de l'Union propulsera en effet la Vallée d'Aoste, de la périphérie à laquelle on la situe aujourd'hui, vers une position, un rôle européen de centre, de noyau de la Région transfrontalière du Mont-Blanc, conjuguant ainsi histoire et nouvelles ambitions.
C'est dans ce contexte, par ailleurs, que s'inscrivent nombre d'initiatives que nous avons mises en place avec nos partenaires francophones, dans les domaines de l'éducation, des services, de l'agriculture, de l'aménagement du territoire ou de la coopération économique, concernant notamment les petites et moyennes entreprises, le tourisme et le secteur tertiaire.
Et, pour mieux manifester l'intérêt que nous portons à l'Europe, nous aurions aimé pouvoir, dès cette année, présenter un budget chiffré en Euro, même simplement à titre indicatif; cela n'a pas été possible, faute de pouvoir fixer un taux de change vraisemblable pour la nouvelle monnaie unique; mais ce n'est que partie remise! Nous sommes certains que le prochain budget présentera cette caractéristique, signe tangible de la réalisation du processus d'intégration européenne.
En ce qui concerne la scène italienne, l'économie a, elle aussi, suivi les tendances européennes et a montré en 1997 une reprise de la production, par rapport aux résultats de 1996. Les tableaux peuvent vous permettre de vérifier ces données.
La baisse de l'inflation, la réduction des taux d'intérêt et la stabilité des taux de change, ainsi que la réussite de l'effort d'assainissement des finances publiques, constituent un cadre globalement favorable. L'augmentation, sous le profil du pouvoir d'achat, du revenu disponible des ménages, devrait se traduire par une augmentation sensible en chiffres réels de la consommation de ces derniers.
Par ailleurs, les effets de la croissance économique n'ont toutefois pas suffi à inverser l'évolution du taux de chômage en 1997, et le marché du travail est encore marqué de fortes rigidités et d'inégalités territoriales.
Pour ce qui est de l'évolution des finances publiques, en revanche, de substantiels progrès ont été enregistrés, en matière de réduction de l'endettement net. Même si le rapport entre la dette publique et le PIB reste supérieur aux limites fixées par les critères de Maastricht (60 pour cent), l'Italie a passé depuis quelques mois le seuil de convergence des deux autres paramètres prévus par le Traité, le taux d'inflation et le rapport déficit public/PIB.
En ce qui concerne l'économie valdôtaine, examinée sous ces deux facettes: la situation réelle de l'économie et sa partie financière, nous pouvons constater qu'en 1997, l'économie valdôtaine, avec une évolution parallèle à celle de l'Italie, a présenté les signes d'une bonne reprise, après la flexion enregistrée en 1996 sous l'effet d'une réduction de la demande intérieure et extérieure.
La baisse de la production a été particulièrement sensible dans le secteur sidérurgique (- 4 pour cent en 1996), qui a subi les effets de la conjoncture économique négative que traversait le marché extérieur, tandis que les secteurs de l'électricité et de l'électronique (+ 13 pour cent en 1996) - représentés dans la Vallée par des entreprises dont la production est caractérisée par une haute teneur technologique - le secteur mécanique (+ 10 pour cent en 1996) et le secteur textile (+ 6 pour cent en 1996) présentaient d'appréciables résultats, grâce aux nouveaux débouchés qu'ils ont su créer sur les marchés extérieurs.
D'autre part, le ralentissement qui a marqué l'économie valdôtaine en 1996 n'a pas eu d'influence sensible sur la situation globale du marché du travail, qui demeure nettement meilleure que celle de l'Italie, puisque le taux de chômage se chiffre à presque 6 pour cent.
Tout comme en 1997, le PIB valdôtain devrait en 1998 présenter un léger accroissement en termes réels et cette évolution positive devrait se répercuter tant sur les investissements que sur la consommation des ménages.
Le marché du travail présentera un cadre essentiellement stable, qu'il s'agisse du nombre des travailleurs ou de celui des demandeurs d'emploi, et le nombre de ces derniers restera nettement inférieur à la moitié de la moyenne nationale.
Les disponibilités financières régionales prévues pour 1998 font enregistrer une augmentation de près de 5,6 pour cent par rapport à 1997, ce qui signifie, en considérant le taux d'inflation prévu (1,8 pour cent pour 1998), que la croissance réelle devrait se chiffrer à 3,8 pour cent. En ce qui concerne l'économie financière, le manque de données officielles pour l'année 1997 - dû au temps nécessaire à leur élaboration par la Banque d'Italie - ne nous permet pas encore d'analyser à fond et avec précision la situation de l'année en cours, ni de formuler des prévisions fiables pour 1998.
Nous pouvons toutefois relever, à la lumière des éléments dont nous disposons, que les financements accordés en 1996 par le système bancaire aux résidants valdôtains ont augmenté de 7,8 pour cent, un chiffre qui dépasse de loin celui de l'Italie. Cette augmentation est essentiellement le fait de l'Administration (+ 39 pour cent) et des sociétés non financières (+ 9,5 pour cent).
Les dépôts bancaires de la clientèle valdôtaine ont diminué en 1996, mais cette baisse a principalement porté sur le court terme, tandis que les dépôts à moyen et long terme ont sensiblement progressé.
Le rapport investissements/dépôts a ainsi connu une nette amélioration.
Conformément à l'évolution de la situation italienne, en Vallée d'Aoste également les taux d'intérêt ont eu tendance à baisser, bien que l'évolution ait été moins marquée qu'en Italie.
L'évolution de la moyenne du "spread" entre taux actifs et passifs néanmoins va à contre-courant de la tendance italienne, raison pour laquelle la différence entre les moyennes des "spreads" de l'Italie et de la Vallée d'Aoste a encore augmenté considérablement.
Passando alla finanza regionale, possiamo constatare che il quadro della finanza regionale è sempre più strettamente collegato alla dinamica dell'economia reale valdostana.
Alcuni indicatori di tendenza mostrano infatti che, nel medio periodo, la finanza regionale muove positivamente verso obiettivi di maggiore autonomia: con un peso sempre crescente dei tributi propri sul totale delle entrate, con una riduzione evidente dell'incidenza percentuale delle entrate regionali rispetto al prodotto interno lordo della Valle d'Aosta - e questo penso sia un dato significativo da evidenziare, anche come conseguimento di un obiettivo, e con dati che dimostrano che diminuisce quest'incidenza e che quindi aumenta la partecipazione dell'economia del settore privato -, con una netta riduzione dell'incidenza dei trasferimenti statali, rappresentati, ormai, quasi esclusivamente da assegnazioni comunitarie.
I tributi propri sono in costante crescita in rapporto al totale delle entrate, passando dal 15,1 percento del 1995 ad un previsione del 17,2 percento per il 1998, mentre la leggera flessione nel rapporto tributi e compartecipazioni sul totale delle entrate è principalmente il risultato di una correzione apportata alla previsione del gettito IVA, sovrastimata per il 1996 e il 1997.
Su questa dinamica, per il futuro, è comunque importante considerare con attenzione il potenziale impatto conseguente all'introduzione di una nuova imposta - l'IRAP, che allo stato attuale di regionale ha solo la denominazione - e della riforma fiscale in generale. E a tal fine, affinché sia garantita la neutralità del nuovo sistema sulla Regione e salvaguardata la nostra autonomia finanziaria, stiamo seguendo con attenzione - e con il prezioso supporto dei Parlamentari valdostani - ogni evoluzione delle decisioni e dei provvedimenti governativi e legislativi in materia.
La tabella vi permette di avere un riferimento delle modifiche che saranno introdotte con l'approvazione di questa nuova imposta.
Aprendo una breve parentesi sulla riforma fiscale, rammentiamo che il gettito proveniente dall'IRAP è stato stimato, per il 1998, in lire 170 miliardi e dovrebbe pertanto compensare, per la Regione, la riduzione delle entrate derivanti dai tributi regionali soppressi.
Ed in questo quadro di incertezza, si stima altresì che, in prospettiva, le minori entrate per i comuni valdostani dovrebbero essere compensate anche dal previsto incremento dell'IRPEF, conseguente alle modifiche introdotte dal decreto ed all'indeducibilità dell'IRAP ai fini IRPEF, dato il meccanismo istituito dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 che prevede che la Regione riservi al finanziamento della finanza locale il 95 percento del gettito IRPEF spettante alla Regione stessa.
Peraltro, per il 1998 - ed in attesa dell'approvazione delle riforme attualmente all'esame del Parlamento e delle previste modificazioni della legge n. 48 - le norme introdotte nella finanziaria regionale dovrebbero comunque assicurare agli enti locali della Valle d'Aosta, e questo in controtendenza rispetto al contesto statale, un incremento di risorse per garantire l'espletamento delle loro funzioni ed il finanziamento dei processi di riforma.
Tornando alla finanza regionale, rileviamo un altro segnale positivo, nella sempre maggiore partecipazione dei privati alla creazione del PIL valdostano, segnale chiaramente deducibile dai dati riportati nella voce entrate regionali su PIL Valle d'Aosta e che mostrano un andamento crescente dal 1995, per giungere, nelle previsioni del 1998, al 37,7 percento.
Inoltre, gli altri indicatori - il PIL della Valle d'Aosta sul PIL dell'Italia, i trasferimenti statali sul totale delle entrate - testimoniano il consolidamento della capacità del sistema valdostano di produrre ricchezza e di partecipare attivamente al rilancio dell'economia italiana (2,6 per mille nel 1998).
Infine, se per il 1998 solo il 25 percento delle entrate regionali trae origine da finanza derivata - l'importo derivante dal trasferimento dello Stato quale quota sostitutiva dell'IVA da importazione - è da rilevare che l'importo di tale trasferimento - circa 500 miliardi - non copre, se non in parte, le spese che sarebbero, in un sistema ad autonomia ordinaria, a carico dello Stato - spese stimate in Valle d'Aosta a circa lire 640 miliardi. È quindi infondata e mistificatoria la critica che viene rivolta alla nostra Regione di essere un'isola di benessere, interamente sostenuta da trasferimenti statali a discapito di altre zone del Paese. Anzi, la Regione sopporta oneri - per il 1998 sono circa 640 miliardi - che altrove sono a carico dello Stato.
In questo contesto il sistema economico locale è cresciuto a tassi superiori alla media nazionale nel periodo 1990-1995 malgrado nello stesso periodo la dinamica delle entrate, in termini reali, sia rimasta sostanzialmente stazionaria.
La dinamica è inversa rispetto al quinquennio ?85-?90, quando con entrate crescenti mediamente del 4,3 percento all'anno, il sistema economico locale si è sviluppato in media ad un tasso inferiore del 25 percento al dato medio nazionale.
L'andamento dei dati nel periodo ?95-?97 - per il ?97 il dato è ricavato dal bilancio di previsione - mostra ancora una crescita del sistema economico locale superiore alla media nazionale. Per quanto concerne la finanza locale, sulla base del progetto di attuazione di un sistema delle autonomie a dimensione della Valle d'Aosta si accrescono autonomia e responsabilità degli Enti locali valdostani, in modo particolare grazie all'applicazione della legge 48.
L'ammontare complessivo di risorse finanziarie è cresciuto, nel 1997, del 9,7 percento circa; nel 1998 la crescita sarà del 3 percento e dei 300 miliardi complessivamente da trasferire agli enti locali nel 1998, il 45 percento circa sono "senza vincolo di destinazione".
Esaminiamo adesso il quadro delle disponibilità finanziarie, presentando innanzitutto i criteri per la loro previsione e poi, distintamente, le entrate e le spese.
Per quanto concerne la previsione delle disponibilità per il triennio, queste sono state formulate sulla base di un'attenta valutazione del quadro macro-economico di riferimento e applicando nelle valutazioni stesse il criterio della "prudenza".
La stima delle entrate risente, perciò, di una determinazione effettuata sì sulla base della legislazione vigente, ma altresì avendo riguardo alle riforme in corso -si pensi all'IRAP. Ed ancora, non sono stati conteggiati - per gli anni 1999 e 2000 - i potenziali trasferimenti comunitari e statali, in attesa sia della loro formale approvazione da parte degli organismi competenti, sia delle nuove disposizioni in materia di fondi strutturali, che dovrebbero avere effetto a partire dall'anno 2000.
Infine, si è proceduto ad un contenimento del peso, sia in valore assoluto sia in valore percentuale, del mutuo a pareggio.
Al lordo dei mutui, le disponibilità finanziarie complessive previste per il triennio si mantengono sostanzialmente stabili in termini reali, sui livelli di poco superiori all'esercizio in corso.
Per il 1998 le previsioni raggiungono i 1972 miliardi (+ 5 percento rispetto al 1997), per attestarsi nel 2000 a 1966 miliardi. La riduzione delle variazioni per il biennio 1999/2000 è essenzialmente legata a valutazioni prudenziali sulle voci "Altre entrate" e "Mutui da contrarre".
Va inoltre considerato che, per il 1999 parzialmente e per il 2000 totalmente, non sono incluse tra le entrate quelle derivanti da possibili cofinanziamenti comunitari e statali - non ancora formalmente approvati, nel primo caso, e non ancora prevedibili nel secondo caso, in quanto collegati alla riforma dei fondi strutturali che, invece, sono ricompresi tra le entrate previste per il 1998.
Da rilevare poi che nella gestione finanziaria, in particolare nella gestione della liquidità, la Regione è penalizzata dall'applicazione del sistema di Tesoreria Unica, che prevede il deposito della liquidità eccedente il 3 percento delle entrate al netto delle partite di giro in un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria Centrale. Ed un ulteriore elemento di penalizzazione verrebbe poi ad aggiungersi qualora dovesse essere approvato - e trovare applicazione - il principio della limitazione dei flussi di cassa previsto dal progetto governativo di Finanziaria per il 1998.
Sostanzialmente, per il 1998 e 1999, vengono confermate le previsioni, relativamente alle entrate effettive, formulate per il triennio 1997-1999.
Al netto dei mutui, le previsioni per il 1998 superano di poco i 1800 miliardi e, per i due anni successivi, si attestano attorno ai 1830 miliardi. Le previsioni di mutuo si mantengono, in percentuale delle entrate, in calo progressivo nel corso del prossimo triennio (8,6 percento nel 1998; 7,7 percento nel 1999; 6,7 percento nel 2000).
Per quanto concerne le entrate, le previsioni di entrata si fondano su:
Un lieve aumento, anche in termini reali, dei tributi propri e compartecipazioni (+ 5,9 percento). Tale andamento è il risultato di:
- una previsione sostanzialmente stabile del gettito delle entrate proprie in quanto il gettito derivante dall'introduzione dell'IRAP è previsto in misura uguale a quello che sarebbe derivato dai tributi regionali soppressi (sostanzialmente i contributi sanitari);
- una dinamica crescente delle compartecipazioni, risultato di un incremento del gettito delle imposte dirette (anche per gli effetti di indeducibilità dell'IRAP) e di una previsione più prudenziale del gettito IVA;
- una stabilità di trasferimenti statali, relativi ai fondi per l'attuazione di interventi, quasi esclusivamente riferiti a programmi comunitari, già definiti o in definizione;
- una sostanziale stabilità delle altre entrate, risultato di un decremento previsto nelle entrate da rendite patrimoniali e di un incremento delle entrate da alienazioni.
Le effettive disponibilità previste per il 1998 (1803 miliardi di lire) consentono di pareggiare le spese con il ricorso a mutui per lire 169 miliardi, riducendo lievemente l'ammontare previsto per l'anno 1997 (173 miliardi).
Dopo il buon andamento delle entrate nel 1997 (1707 miliardi), anche per il 1998 sono previste entrate effettive - al netto cioè dei mutui - in crescita in termini reali (+ 3,8 percento).
La flessione del tasso di crescita reale attualmente ipotizzata per il 1999 e 2000 rispetto al ?98 risente di quegli elementi che abbiamo avuto modo di sottolineare, cioè che non sono includibili i trasferimenti statali o comunitari che saranno approvati nei prossimi mesi, e quindi solo allora "accertabili", e della prudenza nella previsione delle entrate proprie per via delle incognite derivanti dall'introduzione dell'IRAP. Infine, i residui attivi stimati al 1° gennaio 1998 ammontano a 969 miliardi.
Vediamo adesso le linee di intervento, cioè in quali settori si sono indirizzate le risorse disponibili.
Il bilancio quale strumento di programmazione finanziaria e di gestione previsionale è lo specchio della condotta che l'Amministrazione regionale intende adottare; un'Amministrazione attenta alle necessità del cittadino soprattutto per quei servizi e per quegli interventi caratterizzanti uno stato sociale avanzato che punta a migliorare il proprio assetto finanziario, oltre che con l'aumento delle entrate, anche attraverso il contenimento delle spese.
Complessivamente le spese previste per il 1998 ammontano a 1972 miliardi di lire, 91 in più di quanto previsto nel 1996 per il corrente esercizio. Ciò comporta un aumento delle spese del 4,8 percento contro un aumento delle entrate effettive - al netto dei mutui - del 5,6 percento.
Al fine di poter apprezzare appieno lo sforzo intrapreso per una gestione accurata della finanza pubblica, è necessario precisare come non tutte le disponibilità finanziarie consentono una previsione di utilizzo pienamente discrezionale.
Infatti, sui 1972 miliardi di lire di disponibilità totali devono essere evidenziate alcune voci di spesa "obbligatorie", "incomprimibili" nel breve periodo, contenute nell'elenco delle spese che trovate, tra cui spese di funzionamento istituzionale dell'Amministrazione regionale, sanità, istruzione pubblica, trasferimenti e altre voci, il tutto per circa 1030 miliardi, pari al 52,2 percento del totale delle entrate rispetto però al 53,2 percento del 1997, quindi anche questo è un dato in positivo.
La quota di risorse definibile come "l'area delle scelte" incrementa peraltro il proprio peso, passando dal 46,8 percento dell'esercizio in corso al 47,8 percento: oltre 942 miliardi di lire - 62 in più rispetto al 1997 - di cui 869 per interventi consentiti e previsti dalla vigente legislazione e 73 previsti nei fondi globali.
Non va poi comunque dimenticato che, all'interno di tale area, molte poste contabili sono da riferire a leggi in vigore, non modificabili o non sopprimibili senza un'attenta analisi dell'impatto conseguente sulla realtà socioeconomica e senza una concertazione con le categorie di beneficiari che, sulla base di esse, hanno assunto impegni, avviato programmi o realizzato investimenti.
Il necessario processo di revisione della struttura della spesa regionale che l'Amministrazione sta perseguendo richiede quindi sì impegno e determinazione, ma anche gradualità nell'attuazione delle decisioni adottate e delle scelte operate.
La tabella permette di evidenziare quella che è la distribuzione delle spese correnti, spese che nel 1998 sono previste in 1239 miliardi di lire, contro i 1154 miliardi previsti per il corrente anno, passando dunque dal 61,6 percento al 62,8 percento del totale delle spese. L'incremento è da attribuirsi in gran parte alla maggiore quota di spesa corrente nei fondi globali per interventi a carattere istituzionale, rispetto ai passati esercizi. E andremo ad evidenziare le voci che sono presenti in questa quota.
Le spese di funzionamento non variano sensibilmente rispetto al passato esercizio (+ 1,8 percento); tra gli interventi a carattere generale l'aumento più sensibile - anche se non influente in termini assoluti - si registra nelle "Spese per programmi di informatizzazione" di interesse regionale (+ 31 percento).
L'incremento delle spese correnti, pertanto, deriva soprattutto dall'aumento di spesa per interventi a carattere specifico (+5,6 percento), in particolare nel settore "Assetto del territorio" (+ 26,7 percento, dovuto, tra l'altro, al finanziamento dell'ARPA - per 5 miliardi, fino al 1997 trasferiti tramite USL ed ora direttamente attribuiti - e ai canoni di gestione per impianti smaltimento rifiuti - 1 miliardo) e in quello di "Sviluppo economico" (+ 13,5 percento con ben 16 miliardi in più rispetto al 1997).
La riduzione delle spese correnti per la finanza locale si spiega con il decremento dei trasferimenti relativi ai fabbisogni per le spese delle microcomunità in quanto, dal 1998, le quote a carico degli utenti - prima versate alla Regione - sono trattenute direttamente dai comuni.
Nel settore "Promozione sociale", il relativo decremento è invece dovuto essenzialmente all'adeguamento delle spese per l'edilizia scolastica alle effettive possibilità di intervento.
Il maggiore peso percentuale delle spese dipende quindi da numerosi fattori, alcuni dei quali di carattere straordinario come il ripiano dell'U.S.L. (20 miliardi) o la revisione delle indennità per cessazione di servizio al personale regionale che per il 1998 incide per 20 miliardi peraltro, il fattore più significativo è di natura endogena.
Se si depurano, infatti, i 1239 miliardi di spese correnti dagli oneri sostenuti dalla Regione, altrove a carico dello Stato e pari per il 1998 a 639 miliardi di lire, il totale della spesa corrente di natura strettamente "regionale" scende a 600 miliardi, pari al 45,5 percento delle rimanenti risorse disponibili, permanendo oltre il 54 percento delle risorse "regionali" disponibili per gli investimenti.
Particolare attenzione è stata poi posta al contenimento delle spese correnti connesse al funzionamento dell'Amministrazione. La tabella vi permette di confrontare i dati 1996-1997 con il previsionale 1998.
L'incremento verificatosi nel 1997, anche rispetto alle relative previsioni, nelle spese per speciali incarichi e consulenze è, in parte, dovuto all'aumento del contenzioso e delle prestazioni tecniche esterne, motivato dall'accresciuto investimento in opere pubbliche.
L'incremento delle spese di trasferta è invece derivato, nonostante il contenimento dei costi unitari delle trasferte stesse, dal notevole aumento dell'attività extra-Regione del personale regionale, per la cura dei rapporti con le istituzioni dello Stato italiano e dell'Unione Europea.
Sia le spese iscritte in bilancio in base alla "legislazione vigente" che l'ammontare delle risorse iscritte nei fondi globali sono destinate prevalentemente alla copertura di spese correnti, come evidenziato dal sottoriportato prospetto, dove avete la ripartizione, a legislazione vigente e a fondi globali, delle spese.
Si deve tuttavia tenere presente che l'elevata incidenza delle risorse iscritte a fondo globale per il finanziamento di spese correnti è da attribuirsi agli accantonamenti destinati a finanziare il ripiano del disavanzo dell'U.S.L. e il trasferimento, sull'istituendo Fondo di previdenza, di parte dei trattamenti di fine rapporto del personale regionale maturati al 31 dicembre 1997, complessivamente lire 40 miliardi.
Analizzando le spese per investimenti e la loro ripartizione, le stesse ammontano a 740 miliardi di lire per il 1998, sostanzialmente in linea con il dato previsto per l'anno in corso.
La maggior parte degli investimenti concerne interventi per lo sviluppo economico - che, come già evidenziato, sono in crescita rispetto al 1997 - con 250 miliardi; gli altri investimenti si concentrano sulle opere pubbliche, in particolare su viabilità, acquedotti e fognature, e sugli interventi di riqualificazione del territorio e dell'ambiente, pur avendo presente che il buon grado di infrastrutturazione conseguito comporterà per gli anni a venire una maggiore allocazione di risorse per la manutenzione che viene classificata fra le spese correnti.
La ripartizione delle spese di investimento per linee di intervento evidenzia, infine, il peso percentuale dei singoli settori.
I residui passivi previsti al 1° gennaio 1998 ammontano a 999 miliardi.
La maggiore incidenza dei residui passivi si determina nei settori dello sviluppo economico (circa 300 miliardi) e nei settori dell'assetto del territorio e della finanza locale (intorno ai 200 miliardi). In termini generali i residui - sia attivi che passivi - evidenziano peraltro un'inversione di tendenza, dato che dopo essere saliti al 40 percento per le entrate e al 37 percento per le spese, si riportano a valori percentuali più vicini a quelli del 1996, anche se, in valore assoluto, sfiorano entrambi ormai i 1000 miliardi. E questo è un elemento di riflessione per noi tutti, per cercare di migliorare quelle che sono le capacità sia di introito, sia di spesa dell'Amministrazione.
La peraltro sostanziale coincidenza tra i residui attivi e passivi attenua eventuali tensioni sulla liquidità di cassa.
Infine, evidenziamo alcune tendenze nel bilancio triennale e alcuni dati sui fondi globali, che peraltro nel corso del dibattito andremo ad approfondire.
Nel triennio 1998-2000, la Regione prevede di disporre di oltre 5900 miliardi di lire con un incremento del 3,6 percento circa rispetto al triennio 1997-1999. La tabella vi permette di evidenziarne la distribuzione.
Gli oneri di funzionamento ne assorbiranno il 23,65 percento (22,5 percento nel 1997-1999).
Gli interventi per la finanza locale crescono ancora rispetto al triennio precedente del 2,6 percento, pur a parità di funzioni e di competenze e saranno più di 1000 i miliardi destinati agli enti locali della Valle d'Aosta nel triennio 1998-2000.
Per gli investimenti a carattere specifico sono previsti quasi 3000 miliardi nel triennio - la metà delle risorse disponibili - con un incremento - volto a razionalizzare gli interventi e dunque la spesa - di 1,5 percento rispetto a quello precedente.
Crescente attenzione sarà dedicata agli interventi di sicurezza e promozione sociale - in coerenza con l'obiettivo prioritario di favorire il benessere della persona - mentre si stabilizzeranno quelli rivolti all'assetto del territorio ed ambiente - in ragione di maggiori spese di manutenzione rispetto ad investimenti strategici già avviati in passato.
Per quanto concerne i fondi globali, nel triennio 1998-2000 le risorse complessivamente destinate ai fondi globali ammontano a 224 miliardi di lire, pari al 3,8 percento del totale, di cui 73, 69 e 82 miliardi rispettivamente nei tre anni e con un incremento del 10,3 percento rispetto al triennio precedente.
Quasi il 45 percento dei fondi globali è connesso ad interventi in campo istituzionale, qui gioca il peso dei 40 miliardi del ripiano U.S.L. e del fondo di previdenza, mentre circa il 39 percento è rivolto allo sviluppo del sistema economico locale. Mentre la prima area è caratterizzata principalmente da spese correnti (98 percento), la seconda è correttamente rappresentata da spese di investimento (86,8 percento).
I fondi globali del triennio appaiono ripartiti in misura quasi uguale tra le spese correnti (55,9 percento) e spese per investimenti (44,1 percento).
Tale composizione dei fondi globali, in quanto caratterizzata da una prevalenza di destinazione a spese correnti, consente di attenuare fortemente il rischio di inefficienza della spesa. Per i fondi globali destinati agli investimenti infatti, la difficoltà di spesa è enfatizzata dal sommarsi dei tempi tecnici di formazione delle leggi, con quelli di attuazione delle opere.
Enfin, tout en soulignant l'action positive menée par le Gouvernement, au cours de ces années, pour la réalisation du programme de législature et notamment les actions accomplies et les résultats obtenus en 1997, permettez-moi de rappeler aussi certaines des interventions qui marqueront le budget régional de 1998 et des trois années à venir, en les regroupant autour de cinq grands axes.
Et ce, en tenant compte de la période de fin de législature et sans vouloir empiéter sur des décisions et des choix qui incomberont au prochain Gouvernement, mais en lui assurant les conditions nécessaires pour prendre ces décisions et choix.
La Communauté et le Citoyen.
Dans le cadre du développement plus général de la télématique et des télécommunications, un réseau public de services télématiques sera mis en place. Celui-ci permettra aux Valdôtains d'accéder - à des conditions favorables et par voie télématique - aux services publics ainsi qu'aux services en matière de travail, d'enseignement et d'information.
Dans le domaine de la santé, la modernisation de l'hôpital aura sans doute une place importante, mais n'en sera pas moins subordonnée aux résultats d'une étude attentive, fondée sur des analyses approfondies, et au choix y afférent.
Dans le domaine social, il est prévu de promouvoir un politique globale en faveur de la famille, de développer les services destinés aux handicapés et de prendre des mesures pour soutenir le secteur du logement. Au sujet de ce dernier point, la législation régionale en vigueur sera appliquée dans son intégralité, notamment pour ce qui est de la constitution d'un fonds social régional pour l'octroi de financements aux personnes défavorisées. Un observatoire régional du logement sera également constitué et l'on pourvoira à la modification de la loi régionale n° 39. Une nouvelle réglementation sera proposée pour la réforme du IACP et une loi régionale sur les programmes intégrés de reconversion, touchant l'urbanisme, la construction et l'environnement, sera également présentée.
L'attention dont feront l'objet les secteurs de la culture, de l'éducation et de la formation se traduira par diverses interventions qui viseront à favoriser l'utilisation des sites archéologiques et à mettre en valeur l'activité théâtrale locale.
L'effort entrepris dans le domaine de la construction et de l'aménagement de bâtiments scolaires sera poursuivi et nous nous attacherons à promouvoir l'institution d'une université en Vallée d'Aoste, ainsi qu'à mettre en place les cours permettant la préparation d'une licence ès sciences de la formation à partir des accords passés avec des universités tant italiennes que francophones.
La formation professionnelle fera l'objet d'initiatives ponctuelles dont plusieurs seront réalisées avec le cofinancement du Fonds Social Européen.
En ce qui concerne, enfin, le sport et les loisirs, la loi-cadre sur les activités sportives sera mise en application.
Quant à la valorisation du territoire et de l'environnement, différents types d'interventions sont prévus en matière de réhabilitation des sites et de protection de l'environnement. Le procédé d'approbation du PTP sera achevé, suivant la méthode de la concertation entre la Région et les collectivités locales et après examen attentif des observations présentées. Simultanément, un texte unique des dispositions en matière d'urbanistique régionale sera approuvé, qui permettra de rationaliser, de simplifier et d'innover les modalités et les procédures de réglementation de l'utilisation du territoire.
Dans le secteur du traitement des déchets, une action coordonnée et intégrée sera lancée à différents niveaux afin que la collecte séparée des déchets soit intensifiée et que les initiatives de compostage soient soutenues. Parallèlement, de concert avec la Région Piémont et la Province de Turin, il sera pourvu à la construction d'un incinérateur.
Par ailleurs, les plans d'intervention et de requalification d'Aoste et de Saint-Vincent se poursuivront, ainsi que les travaux de réhabilitation du fort et du Bourg de Bard. Viendront s'ajouter à cela la réhabilitation des zones démilitarisées de La Thuile et de Valgrisenche et celle du Marais dans les communes de Morgex et de La Salle. Le projet de pistes cyclables prendra concrètement forme et un terrain de golf sera réalisé.
Le développement du système économique. Dans ce secteur, la redéfinition des compétences entre l'Etat et la Région, la libéralisation du secteur électrique et la privatisation de l'ENEL permettront à la Région de mettre en oeuvre sa propre politique énergétique par le biais de l'approbation du Plan énergétique régional et d'interventions portant sur l'économie d'énergies ainsi que de mesures visant à augmenter la production d'électricité pour soutenir les activités de production et la consommation locales.
En vue du renforcement équilibré des différents secteurs économiques et de la qualification du territoire, éléments qui constituent la meilleure garantie de développement et de création d'emploi, plusieurs initiatives seront réalisées: l'application du programme de construction de fromageries et de structures coopératives agricoles, le soutien et la mise en valeur des productions typiques de qualité, la création d'un réseau régional d'informations touristiques, la construction de l'établissement thermal de Pré-Saint-Didier et l'achèvement de la mise en place des consortiums d'artisans.
Par ailleurs, des initiatives ciblées, spécifiquement liées au soutien de l'emploi, se poursuivront - services d'utilité publique et interventions pour favoriser la création d'emploi -, de même que celles de requalification des aires industrielles (ex-Cogne; ex-ILLSA Viola) et de reconversion de l'autoport.
Enfin, pour soutenir les activités touristiques, de nouvelles dispositions régionales seront élaborées en matière de remontées mécaniques et développement des domaines skiables et la cotation de la fiabilité financière de la Région (rating) permettra à celle-ci de se présenter sur les marchés financiers nationaux et internationaux pour recueillir les capitaux nécessaires au financement des grands projets d'investissement.
Dans le domaine institutionnel, à l'échelon italien il faudra renforcer encore notre autonomie, avec l'application intégrale du Statut par le biais de l'activité de la Commission paritaire.
Nous suivrons par ailleurs avec la plus grande attention l'évolution du processus de réforme fédérale de l'Italie, en présentant des propositions - par l'intermédiaire de nos Parlementaires - pour soutenir et valoriser les autonomies spéciales.
A l'échelon valdôtain, l'objectif prioritaire demeure l'achèvement du projet de réforme des collectivités locales, avec la réalisation du Statut unique de la fonction publique, la régionalisation des secrétaires communaux, l'approbation de la nouvelle loi-cadre des autonomies locales et la réforme de la loi n° 48/95 portant sur les finances locales.
Sur la scène francophone, internationale et européenne, un Bureau de la Vallée d'Aoste s'implantera à Bruxelles, au sein même des institutions de l'Union européenne, et une "Maison de la Vallée d'Aoste" ouvrira aussi ses portes à Paris. Ce qui permettra d'assurer une meilleure participation de la Région aux décisions communautaires et d'exploiter au maximum les opportunités de développement offertes par l'Union européenne.
Par ailleurs, on pourra compter sur un soutien efficace de la promotion de l'image de la Vallée dans la capitale française en imprimant aussi un nouvel élan aux relations que nous entretenons avec les sociétés de l'émigration valdôtaine.
La régionalisation des sapeurs-pompiers sera réalisée, de même que la constitution de fonds régionaux de prévoyance et une large place sera réservée au développement du réseau informatique régional grâce à d'importantes interventions d'informatisation de l'Administration, qui permettront d'en améliorer l'efficacité et l'efficience en la rendant plus transparente et accessible aux citoyens.
Enfin, dans le domaine des transports, les interventions prévues aux fins de l'habilitation au trafic commercial de l'Aéroport régional Corrado Gex seront achevées, de même que les travaux et la mise en service de la liaison ferroviaire Cogne - Plan Praz. La voie ferrée Aoste - Pré-Saint-Didier sera modernisée pour remplir les fonctions de métro du Mont-Blanc.
En conclusion, le budget 1998 - et le budget triennal 1998/2000 - que nous nous apprêtons à discuter, et à voter, représente une étape significative, revêt une importance particulière et constitue un moment de réflexion qui va bien au-delà de sa nature d'instrument financier par lequel se traduisent les choix et se réalisent les projets d'un Gouvernement.
En effet, si d'un côté ce budget - précisément parce qu'il est le dernier de cette législature - représente l'occasion de dresser un premier bilan de la réalisation des objectifs que nous nous étions fixés, de l'autre il assume le rôle de document de programmation financière qui trace la voie de la Vallée d'Aoste vers l'an 2000.
Au cours de ces dernières années nous avons assisté à de nombreux changements politiques et économiques - que ce soit en Italie, en Europe ou dans le monde entier - qui nous ont valu de devoir affronter des situations délicates: la crise des valeurs de nos sociétés, la perte de représentativité des partis politiques traditionnels, les réformes en cours de réalisation de la Constitution italienne et de ses institutions dans le cadre de la transformation de l'Etat dans une optique fédérale le processus d'intégration européenne, la globalisation de l'économie et la mondialisation des marchés.
Les attaques dont sont victimes les autonomies spéciales; le risque d'être absorbées et aliénées, comme petites communautés alpines, dans une Europe dont le seul souci pourrait bien être celui de satisfaire les aspirations des Etats ou celles des "marchands", ou encore de satisfaire les volontés des technocrates bruxellois; les retombées négatives de la globalisation sur le plan de la production et de l'emploi.
Tels sont les grands défis que nous avons dû relever et que nous aurons encore à relever dans un avenir proche.
Ces défis, si nous avons su et pu les relever, nous le devons à la force de notre identité et de notre autonomie, à l'unité et à la cohésion de notre communauté, grâce aussi au renforcement du système Vallée d'Aoste dans son ensemble avec un maintien dynamique de ses valeurs traditionnelles; la réorganisation de l'Administration; la réforme des collectivités locales; la valorisation de nos spécificités culturelles et linguistiques; l'adoption de mesures pour la reconversion de l'économie valdôtaine; la participation directe aux processus de transformation politique en cours, en Italie comme en Europe.
Et aujourd'hui je crois pouvoir affirmer que ce que l'on aurait pu juger des éléments de faiblesse de notre Région - les dimensions territoriales et humaines; la position périphérique et frontalière; les particularités linguistiques et culturelles - sont devenus pour la Vallée et les Valdôtains autant d'atouts, dans l'Italie et l'Europe de demain.
Autant d'atouts qui nous permettent de nous présenter comme une Région solide qui a su tirer de la valorisation de ses spécificités dans le sillon de la tradition et de l'intégration culturelle et sociale, les éléments nécessaires pour s'affirmer et s'épanouir davantage.
Une communauté jalouse, oui, à juste titre, de ses particularités, mais ouverte naturellement vers l'extérieur, principalement sur l'Europe de par sa situation géographique et bilingue et à la fois porteuse et exemple de la validité du projet politique fédéraliste qui, s'il tarde à se réaliser en Italie, a trouvé en Vallée d'Aoste, notamment au cours de cette dernière législature, une première application concrète. Et avec la personne humaine - et ses exigences - au centre de tout choix politique et administratif et avec la mise à exécution, dans le cadre de notre autonomie et des processus de réforme que nous avons entrepris, des principes de subsidiarité, solidarité et participation.
Aussi sommes-nous convaincus de la validité et de l'actualité du projet et des principes inscrits à notre programme, ainsi que des objectifs que nous avons pu poursuivre grâce entre autres à la stabilité, qui au cours de cette législature, a caractérisé la vie politique de la Région.
Nous présentons donc un budget qui:
- se caractérise essentiellement par ses éléments de continuité - dans la conception, la méthodologie, les délais de présentation;
- se veut le support de l'accomplissement des orientations définies dans le programme politique de juillet 1993, mais également et surtout une passerelle idéale d'ouverture vers le 3ème millénaire et un budget qui jette les bases d'un nouvel essor du peuple et de la Communauté valdôtaine.
Tout en ayant comme point de mire la réforme fédérale de l'Italie, l'intégration européenne et la nouvelle dimension de l'économie, le but a été et reste donc de:
- maintenir, valoriser l'identité culturelle, linguistique et institutionnelle de la Vallée d'Aoste;
- consolider, renforcer notre autonomie politique, financière et économique;
- mener à terme les projets de réforme, structurels et organisationnels;
- promouvoir l'essor culturel, social et économique de la Vallée, en favorisant la modernisation et en encourageant la qualité de ses processus, à tout niveau et dans tout secteur.
Et ce, dans un contexte de disponibilités financières et d'interventions, de projets et de choix qui qualifient toujours plus l'action de l'Administration régionale: pour la pleine reconnaissance, à tous les niveaux, de la dimension montagne; pour faciliter le développement socioculturel; pour soutenir les activités économiques et productives, ainsi que l'emploi, en rendant notre système économique toujours plus compétitif et attrayant - par le biais aussi d'un réseau de relations transfrontalières, interrégionales et internationales.
Un grand projet et des ressources qui interagissent, s'intègrent et se concrétisent dans la programmation financière pour le triennat 1998 - 2000, en continuant ainsi non seulement à faire, mais aussi à donner confiance à notre communauté. Et pour continuer à "Etre plutôt que paraître".
Président Avec le rapport du Président du Gouvernement prennent fin les travaux de ce matin. Le Conseil est convoqué aujourd'hui dans l'après-midi à 17h00 pour permettre à tout le monde d'analyser le rapport du Président. Les travaux continueront jusqu'à 20 heures, avec une interruption d'une heure, pour reprendre à 21 heures.
La séance est terminée.